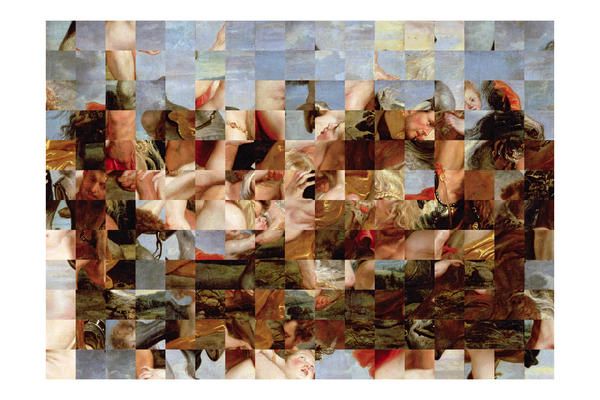Gravure extraite des « Petits mystères de l’Opéra » par Alberic Second. 1844
Ils sont chaud-bouillants d’un côté, pluvieux-venteux de l’autre, mais il ne s’agit pas des conditions météos du jour dans l’Hexagone. Ils sont cuits à l’extérieur et crus à l’intérieur, mais ce ne sont pas des canelés. Ils sont polis en apparence et piquants en vérité, mais ce ne sont pas des piments. Ce sont, ce sont… les Balletos d’Or de la saison 2022-2023. Ne vous bousculez pas, il y en aura pour tous les goûts.
Ministère de la Création franche
Prix Création/Collaboration : Wayne McGregor (chorégraphie), Thomas Adès (musique), Tacita Dean (décors et costumes), Lucy Carter, Simon Bennison (lumières) et Uzma Hameed (dramaturgie) pour The Dante Project (London/Paris)
Prix programmation : Kader Belarbi pour l’ensemble de son œuvre au Ballet du Capitole de Toulouse.
Prix Relecture : Martin Chaix (Giselle, Opéra national du Rhin)
Prix Réécriture : Kader Belarbi et Antonio Najarro revoient les danses de caractère de Don Quichotte (Ballet du Capitole de Toulouse).
Prix du Chorégraphe Montant : Mehdi Kerkouche (Portrait)
Prix Logorrhée : Alan Lucien Øyen (Cri de cœur)
Prix Chi©hiant : Pit (Bobbi Jene Smith / Orb Schraiber)
Ministère de la Loge de Côté
Prix Maturité : Paul Marque (Siegfried)
Prix C’est Arrivé ! : Hannah O’Neill (la nomination)
Prix Mieux vaut tard que jamais : Marc Moreau (la nomination)
Prix Et moi c’est pour quand ? : la versatile Héloïse Bourdon (Mayerling, Lac des cygnes, Études, Ballet impérial)
Prix Jouvence : Sarah Lamb et Steven McRae (Cendrillon d’Ashton)
Ministère de la Place sans visibilité
Prix Humour : Pam Tanowitz (Dispatch Duet, Diamond Celebration à Covent Garden)
Prix Adorable : Amaury Barreras Lapinet (Sancho dans DQ de Kader Belarbi et Loin Tain de Kelemenis. Ballet du Capitole de Toulouse)
Prix Lianes animées : Marlen Fuerte et Sofia Caminiti (Libra de George Williamson. Ballet du Capitole de Toulouse)
Prix de l’Arbre Sec : Sae Eun Park et Silvia Saint-Martin (ex-aequo)
Ministère de la Ménagerie de scène
Prix Bête de scène : Martin Harriague (Starlight. Biarritz)
Prix Pour qui sonne le glas: Le trio de bergers/bovins du Proyecto Larrua. (Idi Begi /Biarritz)
Prix Chaton rencontre un lion : Antoine Kirscher et Enzo Saugar (Le Chant du Compagnon Errant. Programme Béjart. Ballet de l’Opéra de Paris)
Prix Roi des Animaux : Audric Bezard (Boléro, Béjart).
Prix Guépard : Mathias Heymann (première variation de Des Grieux dans L’Histoire de Manon)
Prix Chatounet : Guillaume Diop (interprète un peu vert sur l’ensemble de sa saison)
Prix Croquettes : les distributions masculines de l’Hommage à Patrick Dupond
Ministère de la Natalité galopante
Prix Enfance de l’Art : Myriam Ould-Braham et Mathieu Ganio, merveilles de juvénilité dans L’Histoire de Manon
Prix Déhanché : Charline Giezendanner (Do Do Do, Who Cares ?).
Prix Débridé : Camille de Bellefon et Chun-Wing Lam (S’Wonderful, Who Cares ?).
Prix Boudiou ces Marlous: le corps de ballet masculin du ballet national du Rhin (Giselle, chorégraphie de Martin Chaix)
Prix Je t’aime moi non plus : Ariel Mercuri et Elvina Ibraimova (Demetrius et Helena dans le Songe de Neumeier à Munich).
Ministère de la Collation d’Entracte
Prix Velouté : Amandine Albisson en Manon
Prix Consommé : Le jeu de Pablo Legasa dans Le Lac des cygnes (Rothbart/Siegfried)
Prix Bouillon tiède : Laura Hecquet incolore en Sissi (Mayerling)
Prix Mauvaise Soupe : Concerto pour deux (chorégraphie de Benoit Swan Pouffer, musique de Saint-Preux)
Prix Onctueux : Natalia de Froberville en Dulcinée-Kitri (Don Quichotte de Belarbi)
Prix Savoureux : Philippe Solano en Basilio (Don Quichotte de Belarbi)
Prix Spiritueux : Marc-Emmanuel Zanoli en Espada (Don Quichotte de Martinez).
Prix Régime sans sel: la plupart des danseuses dans la prostituée en travesti à l’acte 2 de Manon.
Ministère de la Couture et de l’Accessoire
Prix de la production intemporelle : Jurgen Rose (Le Songe d’une nuit d’été de Neumeier, Munich).
Prix Brandebourgs et postiches : la pléthore de personnages à costumes dans Mayerling.
Prix Un coup de vieux : les décors et costumes du Lac de Noureev
Prix Mal aux yeux : la nouvelle production pour la Cendrillon d’Ashton (Royal Ballet)
Ministère de la Retraite qui sonne
Prix Tu seras toujours Garance : Eve Grinsztajn (dernier rôle dans Kontakthof, mais on se souvient encore des Enfants du Paradis).
Prix Reviens, Alain ! : Adrien Couvez (les adieux).
Prix Saut dans le vide : François Alu depuis longtemps en roue libre
Prix Étoile filante : Jessica Fyfe, les adieux, dans Instars d’Erico Montes (Ballet du Capitole de Toulouse). Belle prochaine saison au Scottish Ballet !

 Londres. Royal Opera House. Cinderella (Ashton / Prokofiev). Nouvelle production 2023 (Tom Pye Décors/ Alexandra Byrne Costumes/ David Finn Lumières / Finn Ross Video designer) Représentation du dimanche 16 avril 2023.
Londres. Royal Opera House. Cinderella (Ashton / Prokofiev). Nouvelle production 2023 (Tom Pye Décors/ Alexandra Byrne Costumes/ David Finn Lumières / Finn Ross Video designer) Représentation du dimanche 16 avril 2023.



 Royal Opera House, représentation du 17 janvier 2023
Royal Opera House, représentation du 17 janvier 2023