 Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed
Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed
The Dante Project a été créé à Londres à une époque où il fallait montrer patte blanche sanitaire à chaque poste-frontière. Je m’étais donc contenté, pour découvrir la création de Wayne McGregor, du streaming proposé sur le site de Covent-Garden. Mauvaise idée : l’œuvre ne prend pas sens sur écran plat. La partition de Thomas Adès et les créations de Tacita Dean, également monumentales, ont besoin d’espace pour se déployer. Mais surtout, le projet d’ensemble – de la dramaturgie aux lumières, de la chorégraphie aux décors, de la musique aux costumes – ne se laisse vraiment appréhender que dans sa globalité. Aussi vaut-il mieux, pour découvrir pleinement cette création, ne pas se placer trop près de la scène, et résister à la tentation des jumelles : dès qu’on se focalise trop sur un détail, on est sûr de rater quelque chose.
Nous voilà conviés à un voyage en trois temps (Inferno, Purgatorio, Paradiso), dans des ambiances radicalement distinctes. Le pèlerinage dans les cercles de l’Enfer est à la fois éprouvant et impressionnant ; on se sent comme écrasé par le décor – un dessin à la craie reflété par un miroir, qui selon l’éclairage, semble une forêt, une grotte, une montagne ou un immense glacier – sous le regard duquel évoluent des fantômes dont on peine parfois à reconnaître les visages. Cette partie, créée en premier par McGregor, est sans conteste la plus réussie, en tout cas la plus variée du point de vue des rythmes et des humeurs, tant musicales que chorégraphiques. On y rencontre des exilés, des passeurs, des voleurs, un Ulysse rampant et tout caoutchouteux (incarné par un remarquable danseur non identifié dans la feuille de distribution du 3 mai, puis par l’étonnant Loup Marcault-Derouard le 15 mai), des couples au destin tragique (Paolo et Francesca, Didon et Énée), quatre femmes en colère qui se donnent d’impressionnants coups de tête, des devins assez drolatiques, un chemin de croix qui donne lieu à de poignantes figures au sol, un Pape, un grand pas sur une musique de cirque qui donne lieu à une étonnante battle de fin de classe, et, bien sûr, Satan (qui prend la forme, selon les distributions, de Valentine Colasante ou Roxane Stojanov).
Le personnage de Dante, manifestement torturé, est à la fois acteur et spectateur, alternativement au bord du cercle tracé au sol, et puis dedans. Chaque séquence, dans une logique plus atmosphérique que narrative, donne à ressentir une douleur, une tension, une torsion des sens, de l’esprit et du corps. On reconnaît aisément la gestuelle de McGregor, faite d’excès, de profusion et de vitesse, mais contrairement à d’autres pièces du chorégraphe, où l’esbroufe m’a souvent semblé prendre le dessus, les évolutions des danseurs paraissent canalisées par le sens, et on écarquille les yeux pour mieux ressentir, si ce n’est comprendre. La musique d’Adès, qui ne craint ni le pastiche ni les ruptures de style, et se relève orchestralement très riche, contribue sans conteste à cette réussite : quand la partition fait boum-boum, McGregor sombre trop facilement dans le mécanique, alors que si l’on lui donne un ligne mélodique à étirer, il sait aller au-delà de ses tics chorégraphiques.
La création de McGregor est une coproduction asymétrique entre l’Opéra de Paris et le Royal Opera House (à part la confection des costumes, tout vient de Londres), et elle a été clairement réglée sur le corps des danseurs du Royal Ballet, avec notamment un rôle sur-mesure pour Edward Watson, qui a fait ses adieux à la scène dans le rôle de Dante. On n’était pas sûr que les danseurs parisiens pourraient soutenir la comparaison. Eh bien, ils s’en sortent plutôt bien : sans avoir la longiligne figure émaciée du créateur du rôle, Germain Louvet comme Paul Marque s’approprient le rôle avec une visible intensité dramatique (en cela, Louvet est sur la lancée de son très poignant Compagnon errant, tandis que Marque déploie une facette inédite de sa présence scénique).
Le seul élément qui ne fonctionne pas vraiment est le partenariat entre Dante et son prédécesseur en poésie Virgile, incarné à Londres par l’excellent Gary Avis : à Garnier, on a choisi d’apparier Louvet avec Irek Mukhamedov : la prestation de ce dernier, sans être embarrassante, est tout de même un poil pataude, ce qui nuit à la fluidité des pas de deux entre Dante et Virgile. De son côté, Paul Marque danse avec un Arthus Raveau qui, même vieilli par son collier de barbe, reste bien juvénile : du coup, le partenariat manque de densité.
En Inferno, tout est poussière et fumée (la craie qui recouvre certaines parties du corps des danseurs se répand au sol au gré de leurs roulades). La séquence du Purgatorio nous transporte dans une ambiance lumineuse et méridionale, sous le regard d’un grand arbre aux feuilles vert tendre. À une mélopée d’inspiration orientale, correspond une gestuelle apaisée, enroulée et fluide. Ce monde est placé sous le signe de l’amour, Dante – dont le personnage se démultiplie – se remémorant ses trois rencontres avec Béatrice (enfant, jeune et adulte). À la première vision de l’œuvre, le souvenir des fureurs de la première partie m’avait fait trouver ces réminiscences bien pâles. L’impression est toute autre la deuxième fois, et sans doute Léonore Baulac y est-elle pour quelque chose : elle enlace le torse de Paul Marque de son bras avec une fougue qui nimbe de sensualité et de nostalgie toute la suite du pas de deux. La séduction opère et on oublie la technique (là où Hannah O’Neill, plus hiératique, ne fait pas oublier l’acrobatie qu’elle compose avec Germain Louvet).
Pour le Paradiso, Tacita Dean n’a pas réalisé un tableau, mais une vidéo de 30 minutes, diffusée sur un écran au-dessus de la scène. Et il faut faire l’effort de regarder l’ensemble : c’est la connexion entre la vidéo, la danse et la musique, toutes placées en ostinato sous le signe du cercle, qui fait la qualité hypnotique de cette dernière partie. Faisant écho à la musique, la vidéo et les lumières font une boucle qui se répercute sur les danseurs, dont les justaucorps en blanc satiné sont faits pour refléter la couleur. Si l’on ne regarde qu’en bas, ces changements de lumière paraissent très chromo. Mais si on voit l’ensemble, le motif d’ensemble séduit. Et on se rend compte aussi que les évolutions des « corps célestes », bien que dominées par la figure du tourbillon, sont bien plus variées qu’il n’y paraît. Il y a beaucoup à danser pour le corps de ballet dans ce Dante Project, qui est sans doute, à ce jour, la création la plus aboutie de Wayne McGregor et ses comparses.






 Sadeh 21 commence sans crier gare : des personnages seuls isolés déboulent, pieds nus, pour de petites séquences acrobatiques d’environ 30 secondes, durant lesquelles chacun semble lutter contre soi-même. Les interprètes se succèdent sans se rencontrer, l’un quittant la scène avant que l’autre débarque. La scène est vide, encadrée par une muraille grisâtre. Sur la paroi du fond, seront projetés, de Sadeh1 à Sadeh21, les numéros des séquences qui s’enchaînent. On croit un moment que l’énumération correspond au nombre de danseurs dansant ensemble (1, puis 2, etc.), mais c’est une fausse piste : la composition est beaucoup plus inattendue, et les transitions entre séquences plutôt fluides : les changements de numéro, d’atmosphère musicale, de lumière ou de motif chorégraphique ne sont pas systématiquement synchrones.
Sadeh 21 commence sans crier gare : des personnages seuls isolés déboulent, pieds nus, pour de petites séquences acrobatiques d’environ 30 secondes, durant lesquelles chacun semble lutter contre soi-même. Les interprètes se succèdent sans se rencontrer, l’un quittant la scène avant que l’autre débarque. La scène est vide, encadrée par une muraille grisâtre. Sur la paroi du fond, seront projetés, de Sadeh1 à Sadeh21, les numéros des séquences qui s’enchaînent. On croit un moment que l’énumération correspond au nombre de danseurs dansant ensemble (1, puis 2, etc.), mais c’est une fausse piste : la composition est beaucoup plus inattendue, et les transitions entre séquences plutôt fluides : les changements de numéro, d’atmosphère musicale, de lumière ou de motif chorégraphique ne sont pas systématiquement synchrones.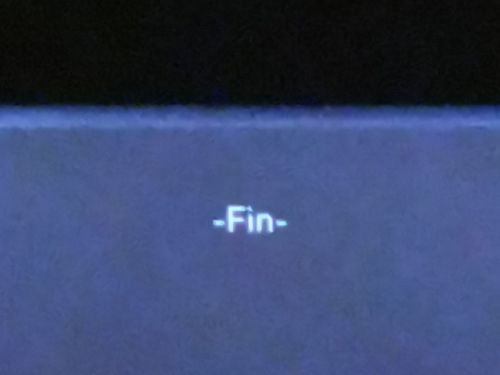













 Grâce à l’Opéra de Paris, j’ai acquis la sérénité face aux durs aléas de l’existence. J’avais organisé mes congés de façon à voir Ludmila Pagliero et Germain Louvet dans L’Histoire de Manon, et j’ai vu Sae Eun Park en partenariat avec Marc Moreau. Le changement d’interprète masculin avait été annoncé de longue date, et j’en avais pris mon parti. Celui affectant le rôle de Manon, découvert en ouvrant la feuille de distribution, m’a fait l’effet d’une douche froide. « C’est la vie », dis-je à ma voisine en affectant un philosophique détachement (11 juillet).
Grâce à l’Opéra de Paris, j’ai acquis la sérénité face aux durs aléas de l’existence. J’avais organisé mes congés de façon à voir Ludmila Pagliero et Germain Louvet dans L’Histoire de Manon, et j’ai vu Sae Eun Park en partenariat avec Marc Moreau. Le changement d’interprète masculin avait été annoncé de longue date, et j’en avais pris mon parti. Celui affectant le rôle de Manon, découvert en ouvrant la feuille de distribution, m’a fait l’effet d’une douche froide. « C’est la vie », dis-je à ma voisine en affectant un philosophique détachement (11 juillet). Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed
Palais Garnier, représentations des 3 et 15 mai – Ballet de l’Opéra de Paris; Musique et direction d’orchestre : Thomas Adès, Chorégraphie : Wayne McGregor, Décor et costumes: Tacita Dean; Lumières; Lucy Carter, Simon Bennison; Dramaturgie: Uzma Hameed


