
Impasse. Scénographie. La maison à géométrie décroissante de Johan Inger. Lumières de Tom Visser
La première partie du programme de gala avait été, si vous vous en souvenez, assez peu roborative. On se réjouissait donc, après un entracte, de retourner dans le vif des choses avec deux ballets du grand Billy (entendez William Forsythe).
*
* *
Las, il faudra attendre encore de longues minutes avant d’être emporté. En effet, je n’ai pas reconnu Rearray, cette pièce créée pour Sylvie Guillem et Nicolas Le Riche en 2011 et vue au TCE en 2012. Certes, le pas de deux a été transformé en pas de trois, mais l’absence totale de réminiscences a sans doute d’autres raisons plus préoccupantes.
Lors de la répétition publique à l’amphithéâtre Bastille vue par Fenella, le répétiteur a en effet livré l’attitude de Forsythe lui-même face au remontage de ses œuvres. « Il n’y a pas de version définitive de ses ballets », « Les interprètes ne doivent pas reproduire ce qui a été fait par d’autres », « un ballet repris peut être transformé ». Tous ces principes, en eux-mêmes semblent fructueux. Forsythe est de cette génération qui a vu les ballets de Balanchine lentement se fossiliser après la mort du maître en 1983 (époque où Forsythe créait sa toute première pièce pour l’Opéra : France Dance).
La création du Balanchine Trust était une grande première. Elle consistait dans le legs des ballets du maître à certains de leurs interprètes, désormais seuls à être autorisés à les remonter dans d’autres compagnies. Le système a vite montré ses limites. Il y eut vite des luttes d’influences et certains imposèrent des règles qui n’étaient pas fixes du vivant du maître. Par exemple, le diktat du non-posé du talon au sol dans les enchaînements rapides s’est généralisé quand il n’avait été conçu par Balanchine que pour contourner le manque de longueur de tendon d’Achille de certains danseurs. Violette Verdy, créatrice de Tchaikovsky-Pas-de-deux, n’a jamais eu à utiliser cet expédient. Figer les règles n’a pas non plus empêché la dérive staccatiste qui à mon sens défigure les ballets du chorégraphe dans sa propre compagnie, le New York City Ballet.
Néanmoins, l’attitude de Forsythe face au remontage de ses ballets qui pourrait se résumer à « le style correct, c’est celui des danseurs qui sont en train de danser » rencontre aussi ses limites. Déjà à l’époque de Rearray avec Guillem-Leriche, je me montrais soulagé de retrouver le Forsythe qui m’avait fasciné depuis le début des années 90 et non une mouture chichiteuse du maître de Francfort. Car il y a le style (qui trop révéré peut scléroser) mais il y a aussi le Style (les spécificités chorégraphiques qui sont le cœur de l’œuvre du créateur).
En 2012, j’avais donc retrouvé les départs de mouvements à la Forsythe, c’est-à-dire de parties complètement inattendues du corps (un genou, une épaule). C’est ce qui justifiait l’accent mis par exemple sur les préparations, habituellement cachées dans le ballet académique et néoclassique mais hypertrophiées ici. Forsythe a ajouté au ballet une approche déconstructiviste, mettant l’accent sur le détail, ce qui rend également l’irruption de la danse et de la virtuosité inattendue et galvanisante pour le public. Les danseurs passent et repassent de l’attitude de ville au balletique sans crier gare. Mais devrait-on écrire « rend » ou bien « rendait » ? Aujourd’hui, de plus en plus, lorsqu’on voit les danseurs marcher sur scène, on a l’impression qu’ils sont sur le catwalk d’une énième Fashion Week. Les positions à poignets cassés ne sont plus déconstructivistes, elles sont tout bonnement maniéristes. La pièce d’occasion deMy’Kal Stromile en était la consternante preuve par l’exemple.
*
* *

Rearray. Roxane Stojanov.
Sans atteindre ce tréfonds, il nous faut reconnaître que Rearray mouture 2024 nous laisse complètement sur le bord de la route. Avec Roxane Stojanov, une subtile interprète qu’on ne peut accuser de maniérisme, tout part du centre attendu chez un danseur d’expression classique. La danseuse va piquer très loin ses pointes (Guillem dansait sur demi-pointes), jusqu’au point de déséquilibre, c’est fort beau, mais son mouvement reste continu quand les fulgurances post classiques devraient naître d’une préparation manquée ou d’une marche de rue. Dans ce Rearray, Roxane Stojanov demeure à chaque instant une danseuse.
En 2012, on s’était émerveillé aussi du mystère de la pièce : était-on face à un duo ou à un double solo ? Ici, la question ne se pose plus vraiment. Takeru Coste et Loup Marcault-Derrouard (qui parvient à se désarticuler d’une manière conforme à l’esthétique Forsythe) nous offrent ce jeu de nœuds trop léché avec leur partenaire qu’on a vu et revu partout. C’est la malédiction Forsythe en plein.
* *
Blake Works I, qui est fabriqué sur la joliesse inhérente à l’école française, ressort mieux. Ces badinages chorégraphiques sur les musiques suaves à paroles sombres de James Blake mettent la compagnie en valeur. Au soir du 9 octobre, beaucoup des créateurs du ballet en 2016 sont encore dans les rangs et ont, pour certains, monté dans la hiérarchie.

Blake Works. Curtain calls
Léonore Baulac est toujours aussi lumineuse dans son rôle avec ses lignes pures, son mouvement continu et sa sensibilité à fleur de peau. Elle accomplit, une fois n’est pas coutume, un très beau duo avec Germain Louvet qui reprend le rôle de François Alu. Le pas de deux « The Color in Anything », qui à l’époque semblait teinté d’une charge « biographique » (on avait le sentiment d’assister à une scène de rupture amoureuse) ressemble aujourd’hui à ce qu’il était vraisemblablement dès le départ, l’évocation d’un travail de studio en cours qui résiste à devenir pas de deux. Les mains se croisent, les passes se tentent et avortent. On sent la frustration poindre chez l’interprète féminine face à son chorégraphe-partenaire à moins que ce ne soit elle la créatrice et lui le modèle rétif. Le trio « Put that Away » avec Pablo Legassa, Caroline Osmont et Inès McIntosh (nouvelle venue dans ce ballet), avec ses poignets cassés et ses poses de chat, fait penser à une version moderne du mouvement flegmatique des Quatre Tempéraments de Balanchine. On est fasciné. Hohyun Kang danse avec une jolie énergie et de belles lignes le rôle de Ludmila Pagliero même si on regrette les gargouillades ciselées de la créatrice. Le duo final avec Florent Mélac manque de recueillement intérieur. Hugo Marchand, qui a le mérite de montrer l’angularité de la chorégraphie, ressort moins que dans mon souvenir. Il me semble qu’il marque joliment. On est cependant satisfait de l’ensemble du ballet porté par sa vingtaine d’interprètes.

Blake Works. Saluts
Le constat de cette section de la soirée reste néanmoins mitigé.
*
* *
Après un nouvel entracte, on va pouvoir enfin assister à la première pièce de Johan Inger entrée au répertoire du ballet de l’Opéra : Impasse.

Impasse. Répétition publique à l’Amphithéâtre Bastille. Fernando Madagan (répétiteur), Ida Viikinkoski, Marc Moreau et Andrea Sarri.
J’avais pour ma part assisté à la répétition publique à l’Opéra Bastille, le 21 septembre. Le répétiteur Fernando Madagan avait choisi de présenter le trio central du ballet. L’ensemble était on ne peut plus prometteur. La chorégraphie, très fluide, avec ses marches et ses glissés au sol, ses corps qui dessinent des volutes, ses dos qui s’arquent vers le ciel et conduisent à des chutes rattrapées par les partenaires, sont dans la veine post classique. Il y a également une veine ekienne (Inger n’est pas Suédois pour rien) avec ses marches sur genoux pliés, ses poses assises jambes écartés et ses gestes du quotidien hypertrophiés, ses rires et des dandinements comiques. Le chorégraphe ajoute même une note folklorique en réaction à la bande son apposant Ibrahim Maalouf et Amos Ben-Tal.
Dans son solo, Ida Viikinkoski accomplit des sortes de sauts temps de flèche attitude en reculant qui sont une véritable déclaration d’innocence. Dans le duo, Andréa Sarri est lui aussi dans le charme et l’insouciance en dépit du gros patch qu’il porte à l’épaule gauche. Bien que le duo se transforme en trio, avec l’arrivée de Marc Moreau, on ne repère pas de rivalité entre les garçons pour la fille. Le répétiteur revient sur des nuances d’interprétation ou sur des dynamiques de mouvement qui vont changer le sens et le perception du passage. Viikinkoski est très réactive. Moreau se voit souvent reprocher de ne pas être assez dans le relâché au début mais se reprend bien. Il reste néanmoins plus sur le contrôle que les deux autres. On ne se refait pas. Fernando Madagan annonce qu’il y aura sur le plateau une puis deux puis trois maisons rétrécissant l’espace au fur et à mesure que les danseurs entreront en nombre toujours croissant. Trois groupes différents s’additionneront au final : le trio, les gens de la ville puis les royalties et autres excentriques. Le titre de la pièce, « Impasse » ferait référence au sentiment d’enfermement et d’inéluctable créé par le COVID. Comme pour la soirée Cherkaoui, Voelker, Kerkouche à l’Opéra en novembre 2020, Impasse fut finalement créé en ligne par les danseur junior du Nederlands Dans Theater (NDTII)…

Impasse. Johan Inger. Saluts
Au soir du 9 octobre, le résultat final laisse pourtant un tantinet perplexe. Si on y retrouve les qualités des ballets de Johan Inger. Il y a d’abord son habileté à lier sa chorégraphie à la scénographie, à la différence de ce qu’a pu faire le duo Leon-Lightfoot au NDT. On apprécie la séquence des Oty People (les gens de la ville), presque music-hall, avec son drôle de va-et-vient ramenant toujours plus de danseurs qui s’ajoutent. On comprend enfin la symbolique de l’arrivée des personnages colorés et divers : d’abord tentés par le conformisme (le trio se change pour le costume unisexe noir des citadins), nos trois innocents d’hier sont confrontés aux sirènes de l’ultra individualisme. Ils échappent in extremis à cette apocalypse vociférante en se glissant sous le rideau couperet qui descend lentement sur le devant de la scène. Pourtant, cette dernière séquence avec ces gesticulations et ces cris nous perd un peu. On se remémore certaines pochades déjantées proposées par Kylian à la fin de sa direction à La Haye. On ne s’est pas ennuyé, non. Johan Inger sait composer un ballet. Mais on ne ressort pas aussi inspiré qu’on a pu l’être après certaines de ses productions. Le succès est d’estime et on espère que le directeur de la danse saura donner une autre chance au Suédois qui serait à même d’enrichir le répertoire du ballet de l’Opéra de Paris.
Au final, ce programme d’ouverture, celui de la première saison authentique de José Martinez à la direction de la Danse, aura été truffé d’occasions manquées.

















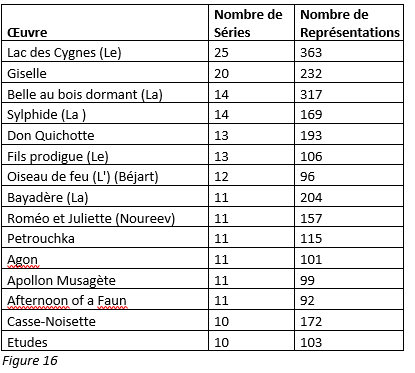























![P1040263 Maxime Thomas, Guillaume Charlot [Petit] / Ludmilla Pagliero [Pas]](https://i0.wp.com/lesballetonautes.com/wp-content/uploads/2013/03/p1040263.jpg?w=496&h=372&ssl=1)
