 La Belle au bois dorrmant (Tchaïkovski. Chorégraphie Rudolf Noureev d’après Marius Petipa). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentations du 11 et 13 mars 2025.
La Belle au bois dorrmant (Tchaïkovski. Chorégraphie Rudolf Noureev d’après Marius Petipa). Ballet de l’Opéra de Paris. Représentations du 11 et 13 mars 2025.
A l’Opéra, La Belle au bois dormant dans la version Rudolf Noureev a enfin retrouvé la scène après près de onze ans d’absence. A ce stade, la presque intégralité des étoiles de la compagnie qui étaient distribuées lors de la saison 2014 ont pris leur retraite et bien peu des membres de la compagnie actuelle y ont usé leurs chaussons. On était en droit de se demander si le ballet de l’Opéra allait se montrer à son meilleur lors de cette reprise bien tardive. Mais somme toute, après une générale qui ne fut pas ouverte au public, le corps de ballet, qui intègre pour la première fois les membres de sa toute nouvelle compagnie Junior, s’est montré à la hauteur des attentes. Les nymphes et les pages escortant le sextet des fées au prologue et les valseurs à cerceaux fleuris de l’acte 1 forment de beaux ensembles. A l’acte deux, les dryades du corps de ballet dessinent un parc à la française dont les allées, toujours mouvantes, cachent ou révèlent la vision d’Aurore aux yeux de princes énamourés.

La Belle au Bois dormant. Soirée du 13 mars.
Pour ce qui est de la boite à friandises que représentent les nombreuses variations solistes et demi-solistes, surtout féminines, les fortunes sont bien sûr plus diverses (pensez ! 6 fées, 4 pierres précieuses, un oiseau bleu et sa princesse, un chat botté et sa chatte blanche). Lors des deux soirées qu’il nous a été donné de voir, le pas de six des fées du 13 mars nous a semblé plus homogène que lors de la soirée du 11. Alice Catonnet était fort délicate en fée Candide. Ses jolis ports de bras évoquaient la peau douce qu’elle octroyait généreusement en vœux à la jeune Aurore au berceau. Camille Bon, moins déliée le 11 en Lilas, était élégante en fée Miette de pain qui tombe. Le duo dynamique Fleur de farine, très inspiré de Barocco de Balanchine, avec Hortense Millet-Maurin et Elisabeth Partington, était dynamique et bien assorti. Clara Mousseigne faisait preuve d’autorité mais aussi de moelleux en fée Violente. Eléonore Guérineau dansait sa fée Canari à la vitesse du Cupidon de Don Quichotte. Enfin, Héloïse Bourdon dépeignait une sixième fée sereine, aux lignes étirées et aux équilibres suspendus. Lors de la soirée du 11, on avait néanmoins apprécié l’élégance de ligne de Fanny Gorse en Miette de pain, l’élégance dans la prestesse d’Ambre Chiarcosso dans le duo Fleur de Farine ou encore l’articulation de la variation aux doigts par Célia Drouy, plus fée résolue que fée violente.
Pour les fées pantomimes, car Noureev a décidé d’adjoindre à Carabosse une fée Lilas exclusivement mimée, on a tout aussi bien goûté l’interprétation plus sardonique que maléfique de Sarah Kora Dayanova (le 11) que celle, très vindicative, de Katherine Higgins (le 13). Le duo antagoniste Higgins-Carabosse et Gorse-Lilas livre une très accentuée et très vivante scène de contre-malédiction à la fin du prologue.
*
* *
L’une des difficultés pour entrer dans ce monument qu’est La Belle au bois dormant est bien sûr l’arrivée tardive de la protagoniste principale. Après la longue scène d’exposition des fées, il faut passer à l’acte 1 par l’épisode des tricoteuses et la grande valse aux arceaux avant de découvrir enfin Aurore. On est toujours impressionné par la gageure que représente cet acte 1 pour la ballerine principale : une entrée vive à base de grands jetés pour exprimer l’extrême jeunesse de la princesse, bouillonnante d’énergie, puis le redoutable pas d’action, sorte de rituel de cour, où Aurore doit tout à coup se modérer en vue des fameux équilibres à assurer aux mains de quatre partenaires différents ; mais il y a encore la variation à équilibres arabesques et pirouettes où la princesse démontre son charme et sa bonne éducation, et, pour finir, la coda explosive de la tarentule qui fait avancer l’action vers le dénouement dramatique et la réalisation de la prophétie. En l’espace de quelques minutes, il faut que le personnage soit planté et que la salle soit tombée amoureuse de l’héroïne pour tout le reste de la soirée.
Les deux jeunes ballerines qu’il nous a été donné de voir relèvent le gant de l’acte 1 avec brio et élégance.
Le 11 mars, Inès McIntosh est très légère et comme montée sur ressorts lors de sa première entrée. Les grands jetés sont légers et le bas de jambe bien ciselé. Dans sa variation finale, elle accomplit des renversés très cambrés sans sacrifier le naturel. Elle est une Aurore de seize ans évidente. L’Adage à la rose est déjà bien en place ; les équilibres ébouriffants viendront sans doute plus tard mais on échappe à la sensation d’exercice difficile qu’on peut parfois observer chez certaines ballerines. La scène de la piqure d’aiguille est presque abordée comme la scène de la folie de Giselle ; la jeune princesse semble perdre le sens de la réalité avant de s’effondrer.
Le 13 mars, Bleuenn Battistoni, dont c’est la deuxième représentation, est une belle fleur déjà éclose, une presque adulte. Elle a une aura de princesse lointaine : l’image de Catherine Deneuve dans Peau d’âne de Jacques Demy nous vient à l’esprit. Elle semble très à son aise dans le cérémonial de l’Adage à la rose. La première série des équilibres est sans doute encore un peu nerveuse, mais Battistoni semble gagner en contrôle et en puissance sur le passage, comme répondant au crescendo orchestral, et le final aux promenades attitude est serein et déjà presque régalien. La petite tension du début, opposée à cette conclusion pleine d’assurance, s’offre comme une évolution psychologique du personnage. La belle variation qui suit poursuit le récit psychologique. Après l’attitude, Aurore montre la position plus décidée de l’arabesque et la jeune ballerine sait suspendre ses piqués avant d’accomplir une série de pirouettes impeccables : élégance et maîtrise… On se laisse porter par le final. Piquée par l’aiguille de Carabosse, Bleuenn-Aurore dépeint à merveille la lente absence au monde qui prend possession de son personnage.
A la fin de ce premier acte, on peut dire qu’on a été conquis par les deux Aurore.
*
* *
L’acte 2 est celui où l’on fait la connaissance du prince Désiré. C’est également l’acte où Rudolf Noureev a mis le plus de lui-même. A l’origine, il n’y avait dans La Belle au Bois dormant que deux variations classiques masculines et elles se situaient à l’acte 3 : celles de l’Oiseau bleu (créée par Enrico Ceccheti qui jouait Carabosse dans les actes précédents) et celle de Désiré. Même la variation d’entrée traditionnelle du prince est un ajout de Konstantin Sergeev datant de l’époque soviétique. Noureev, qui remonta la plupart des grands Petipa en Occident en réévaluant la place de la danse masculine, a particulièrement étoffé la place du prince à l’acte 2 au point qu’on serait tenté d’appeler la scène de la vision, l’acte de Désiré qui ferait suite à celui d’Aurore. A la contribution Segueev, Rudolf Noureev ajoute la longue variation méditative sur le passage musical de l’Entracte qui suivait le panorama dans la production originale. Il ajoute aussi une variation masculine durant le pas d’action sur la variation originale de Carlotta Brianza pour l’acte 2 que Petipa avait chorégraphié sur un passage musical du 3e acte [le chorégraphe donne d’ailleurs la même combinaison de pas à Désiré : une série de battements raccourcis-passés]. Enfin, il conclue la vision par une diagonale de brisés et de sauts chats pour le prince qui donne l’impression que c’est Aurore qui poursuit le prince de ses avances et non l’inverse.
Autant dire que les danseurs qui interprètent le prince ont une tâche au moins aussi écrasante que celle des Aurores de l’acte 1. La variation test reste incontestablement la méditation, non pas tant en raison de son extrême longueur mais bien parce qu’il faut qu’elle soit habitée pour ne pas se transformer en un répertoire fastidieux de toutes les tics chorégraphiques noureeviens : décentrements, fouettés, changements de direction et j’en passe. Habitée, cette variation est un grand moment. Le prince semble ouvrir son cœur au public : les changements de direction, les fouettés sont comme autant de questions que se pose le héros. L’incertitude doit régner. A la fin, une combinaison de batterie ressemble à un jeu de marelle durant lequel le prince dit adieu à l’enfance pour entrer dans la maturité.
Las, aucun des deux princes n’est encore au niveau artistique requis pour faire vivre ce passage clé de la Belle de Noureev. Messieurs Docquir (11) et Diop (13 mars) partagent le triste privilège de faire une entrée absolument anodine en redingote jaune et tricorne assorti. Mais, point commun plus assurément enviable, ils maîtrisent tous deux la chorégraphie complexe du prince. Cependant, Thomas Docquir fait tout bien mais, à ce stade de sa carrière, son personnage ne naît pas de l’addition de ses qualités techniques. Du coup, on est cueilli un peu à froid par la vision d’Aurore. Comble de l’infortune, Inès McIntosh, qui danse moelleux, n’est pas encore une Aurore du deuxième acte. Ses fouettés de l’arabesque à la quatrième devant pendant le jeu de cache-cache avec le prince n’ont pas ce caractère suspendu qu’on attend d’une chimère.

Inès McIntosh et Thomas Docquir
Guillaume Diop quant à lui égrène consciencieusement ses variations. On apprécie toujours ses belles lignes mais on regrette quelques imprécisions dans les pas de liaison. Surtout, la seule chose qu’on observe durant la variation introspective, c’est le soliloque du danseur qui se répète les indications du répétiteur afin d’atteindre gracieusement la position suivante. C’est dommageable pour la chorégraphie de Noureev, si souvent accusée à tort d’additionner les difficultés techniques pour la difficulté technique. C’est en effet l’impression que cela donne quand elles ne sont pas habitées. C’est dommage, car Bleuenn Battistoni est une vision idéale de suspension et de poésie. Mais en face de ce prince autocentré, elle a plus l’air de tenter de le vamper que de le séduire.

Bleuenn Battistoni et Guillaume Diop
*
* *
L’acte 3 est du genre des grand pas détachés de l’action dans lesquels Petipa excellait. Il ne souffre donc pas du défaut de cohérence dramatique qui caractérisait l’acte 2. Dans les pierres précieuses, on apprécie les deux messieurs de l’or ; Nicola di Vico, le 11, qui met en valeur les directions et Andrea Sarri, le 13, qui incarne absolument le métal enserrant les gemmes. Les dames sont mieux assorties le 13 mars. Célia Drouy est un diamant facetté aux côtés de Camille Bon, Clara Mousseigne et Sehoo Yun. Dans le pas de deux de l’oiseau bleu, la préférence va résolument à la distribution du 13 mars. Chun-Wing Lam et sa batterie impeccable dépeignent un véritable oiseau face à la Florine délicate mais plus terre à terre d’Elisabeth Partington. Le 11, c’est Hortense Millet-Maurin qui est l’oiseau tandis qu’Aurélien Gay (pieds vilains, tête vissée dans le cou mais technique saltatoire dominée) délivre sa variation en mode Hercule de foire. On a eu, nonobstant la très jolie interprétation d’Eléonore Guérineau le 13 aux côtés d’Isaac Lopez Gomez, un vrai coup de cœur pour la chatte de blanche primesautière et moqueuse de Claire Gandolfi qui menait la vie dure au chat botté facétieux de Manuel Garrido.
Le pas de deux entre Aurore et Désiré suscite à juste titre l’admiration du public. Messieurs Docquir et Diop sont des partenaires sur lesquels une ballerine peut compter notamment dans les spectaculaires pirouettes-poisson de la grande entrée. Inès McIntosh (aux jolis et spirituels pas de cheval) est charmante et délicate dans sa variation tandis que Bleuenn Battistoni impressionne par ses retirés souverains et la précision sans raideur de ses ports de bras. Guillaume Diop accomplit une série de coupés jetés roborative qui met légitimement les spectateurs en émoi.
Le compte n’y est donc pas encore tout à fait mais on ne ressort pas abattu de ces longues soirées. La série conséquente (une trentaine de représentations sur deux périodes) devrait permettre à chacun de peaufiner sa partition. Bleuenn Battistoni a d’autres dates. Inès McIntosh n’en disposait pour le moment que d’une mais qui sait… Thomas Docquir est également le partenaire d’Héloïse Bourdon. Guillaume Diop, quant à lui a été chargé de 14 dates. S’il survit à cela, il ne pourra qu’en sortir grandi techniquement et, on l’espère aussi, en tant qu’interprète.










 Don Quichotte réserve des surprises. À la faveur d’un énième changement de distribution, Léonore Baulac danse avec Guillaume Diop. Ce dernier est, pour moi, une découverte : je l’ai sans doute vu sans le regarder dans le corps de ballet, et le voilà au centre de la scène, presque sans être passé par la phase des rôles semi-solistes. Ce parcours-éclair aurait de quoi intimider bien des interprètes, mais chez damoiseau Diop, rien n’y paraît : dès l’entrée en fanfare et le grand saut-écart, le personnage est là, élégant et gouailleur. Le partenariat, jamais scolaire, est au contraire tendrement joueur. Voilà un bailarín bien prometteur (oui, je lui décerne un titre en espagnol). Même si certains aspects restent à polir – les portés à un bras de la fin du 1er acte, les tours à la seconde de la coda du 3e – Guillaume Diop fait preuve d’une maîtrise scénique remarquable; au niveau chorégraphique, il ne semble déconcerté que par les redoutables tours en l’air en retiré finis en arabesque de la scène du mariage, si peu payants d’autant que sans élan, et que seuls les plus aguerris parviennent à rendre fluides.
Don Quichotte réserve des surprises. À la faveur d’un énième changement de distribution, Léonore Baulac danse avec Guillaume Diop. Ce dernier est, pour moi, une découverte : je l’ai sans doute vu sans le regarder dans le corps de ballet, et le voilà au centre de la scène, presque sans être passé par la phase des rôles semi-solistes. Ce parcours-éclair aurait de quoi intimider bien des interprètes, mais chez damoiseau Diop, rien n’y paraît : dès l’entrée en fanfare et le grand saut-écart, le personnage est là, élégant et gouailleur. Le partenariat, jamais scolaire, est au contraire tendrement joueur. Voilà un bailarín bien prometteur (oui, je lui décerne un titre en espagnol). Même si certains aspects restent à polir – les portés à un bras de la fin du 1er acte, les tours à la seconde de la coda du 3e – Guillaume Diop fait preuve d’une maîtrise scénique remarquable; au niveau chorégraphique, il ne semble déconcerté que par les redoutables tours en l’air en retiré finis en arabesque de la scène du mariage, si peu payants d’autant que sans élan, et que seuls les plus aguerris parviennent à rendre fluides.




 Avec le programme Balanchine-Robbins-Cherkaoui/Jalet, c’est Benji-New York City Ballet qui s’exprime. Les soirées unifiées par le choix d’un compositeur – ici, Maurice Ravel – mais illustrée par des chorégraphes différents sont monnaie courante depuis l’époque de Balanchine dans cette compagnie.
Avec le programme Balanchine-Robbins-Cherkaoui/Jalet, c’est Benji-New York City Ballet qui s’exprime. Les soirées unifiées par le choix d’un compositeur – ici, Maurice Ravel – mais illustrée par des chorégraphes différents sont monnaie courante depuis l’époque de Balanchine dans cette compagnie.

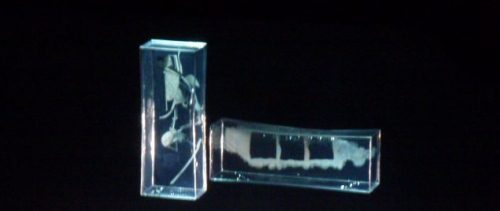 Avec le programme Cunningham-Forsythe, le ballet de l’Opéra est accommodé à la sauce Benji-LA Dance Project. Paradoxalement, ce placage fonctionne mieux en tant que soirée. Les deux chorégraphes font partie intégrante de l’histoire de la maison et les pièces choisies, emblématiques, sont des additions de choix au répertoire.
Avec le programme Cunningham-Forsythe, le ballet de l’Opéra est accommodé à la sauce Benji-LA Dance Project. Paradoxalement, ce placage fonctionne mieux en tant que soirée. Les deux chorégraphes font partie intégrante de l’histoire de la maison et les pièces choisies, emblématiques, sont des additions de choix au répertoire.




 Avec un sens du timing qui n’appartient qu’à eux, les Balletonautes vous proposent leur bilan du Lac des cygnes à l’Opéra de Paris qui a clôturé l’année 2016. Vous reprendrez bien un peu de Lac des cygnes ? Cette série s’offrait en fait comme une sorte de charnière. C’est peut-être le 31 décembre 2016 que s’achevait réellement l’ère Millepied avec en prime une nomination. Désormais les regards se tournent vers la nouvelle directrice et sa première saison que nous commenterons sans doute ultérieurement.
Avec un sens du timing qui n’appartient qu’à eux, les Balletonautes vous proposent leur bilan du Lac des cygnes à l’Opéra de Paris qui a clôturé l’année 2016. Vous reprendrez bien un peu de Lac des cygnes ? Cette série s’offrait en fait comme une sorte de charnière. C’est peut-être le 31 décembre 2016 que s’achevait réellement l’ère Millepied avec en prime une nomination. Désormais les regards se tournent vers la nouvelle directrice et sa première saison que nous commenterons sans doute ultérieurement.








 Giselle, Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du 8 juin 2016.
Giselle, Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du 8 juin 2016.