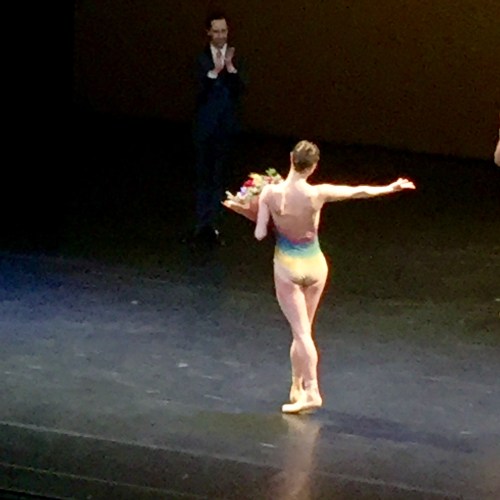Le week-end dernier s’achevait la trente-troisième édition du Temps d’Aimer la Danse, à Biarritz et désormais dans tout le Pays basque ; l’occasion pour l’amateur de danse de faire des découvertes tout en arpentant les lieux culturels et autres agoras de la ville balnéaire. La direction du festival se défend de rechercher des thèmes pour chaque édition afin de préserver la diversité des propositions et l’étendue de la palette des découvertes. Mais mon esprit d’archiviste prévaut le plus souvent et, à mon corps défendant, les articles me viennent par thèmes.
Le week-end dernier s’achevait la trente-troisième édition du Temps d’Aimer la Danse, à Biarritz et désormais dans tout le Pays basque ; l’occasion pour l’amateur de danse de faire des découvertes tout en arpentant les lieux culturels et autres agoras de la ville balnéaire. La direction du festival se défend de rechercher des thèmes pour chaque édition afin de préserver la diversité des propositions et l’étendue de la palette des découvertes. Mais mon esprit d’archiviste prévaut le plus souvent et, à mon corps défendant, les articles me viennent par thèmes.
Pour cette édition, une jeune compagnie franco-suisse (jeune par son fondateur, Edouard Hue, un trentenaire, plus que par sa date de création, 2014) a décidé, dans une optique éco-responsable très en accord avec la philosophie du festival, de présenter plusieurs spectacles et animations à Biarritz au lieu de ne faire qu’une simple apparition. C’était l’occasion de découvrir deux pièces très contrastées du chorégraphe-directeur dans deux théâtres biarrots et de réunir ainsi un premier bouquet d’impressions pour un article.
*
* *

Yume. Beaver Dam Company. Photo ©Olivier_Houeix
Au Colisée, la salle plus particulièrement dédiée aux spectacles courts ou peu gourmands en décors lors du festival, quatre danseurs de la Beaver Dam Company présentaient Yumé, un spectacle chorégraphique à destination des enfants dès l’âge de 4 ans. S’inspirant de l’esthétique des films d’animation japonais, Edouard Hue nous raconte la loufoque et touchante histoire d’une jeune fille à la recherche de son ombre fugueuse.
Le rideau se lève découvrant une danseuse debout lisant un livre. Au sol, un corps tout emmitouflé de gaze gris anthracite, la tête cagoulée, les pieds connectés à ceux de la danseuse, lit également un livre en négatif. C’est l’ombre de la jeune fille. Mais voilà que trois autres ombres en goguette (gestuelle cartoonesque avec marche les genoux très haut levés et mouvements de bras saccadés) entraînent l’ombre lectrice dans leur sillage. La jeune fille, employant un vocabulaire contemporain plus fluide à base de grandes ellipses initiées par les bras se communiquant au torse, part à la recherche de son double gyrovague.
La quête de l’ombre élusive qui dure trois-quarts d’heure, un format idéal pour le public visé, est prétexte à des images poétiques qui séduisent par leur minimalisme et par la fluidité de leur enchaînement. La jeune fille sera aux prises avec un champ de fleurs mouvantes (trois des ombres portent sur le dos des sortes de couvertures articulées hérissées de fleurs pourpres rigides). De petits nuages actionnés au bout de bâtons par les danseurs-ombres, rendus invisibles dans la pénombre, deviennent tour à tour des bébêtes à poil, un truc en plume ou encore une perruque de marquise rococo. Un papillon-poudrier ne cesse de s’échapper au milieu d’une cohorte de nuages montés sur tubes sonores. On rencontre aussi un dragon de nouvel an chinois et un monstre marin, sorte de piranha atrabilaire, lors d’une scène de tempête marine.
Durant cette odyssée à travers les éléments (la terre, l’air, le feu et l’eau), les ombres, qui poussent parfois des petits cris de souris en détresse s’humanisent peu à peu : le contact des mains et du bout du nez entre la jeune fille et l’une d’entre elles est particulièrement touchant de même que le final où la fille prodigue rejoint sa propriétaire, non sans imposer à celle-ci ses trois camarades d’école buissonnière. Yumé est incontestablement un spectacle gracieux.

Yumé. Beaver Dam Company. Photo ©Olivier_Houeix
*
* *
Le lendemain, cette fois-ci au Théâtre du Casino, la Beaver Dam Company présentait All I Need, une pièce créée la même année que Yumé (2021), cette fois-ci à destination des adultes. Edouard Hue, qui a dansé, comme beaucoup de chorégraphes de la jeune génération, pour Hofesh Shechter, est très marqué par le style puissamment physique et ancré dans la terre de la danse israélienne. Les neufs danseurs de la compagnie, aux physiques très individualisés, scandent la musique percussive ou atmosphérique de Jonathan Soucasse en accomplissant de petits sauts ancrés dans le sol, projettent bras et épaules dans toutes les directions et font osciller leur buste de manière très expressive.
Dans un espace brut, sans décors ni effets d’éclairages superflus, les danseurs d’All I Need semblent interroger la notion d’appartenance au groupe ainsi que la constante recherche de l’approbation d’autrui qui l’accompagne.
Lors de la première section, les danseurs, en sous-vêtements croquignolets, dansent d’ailleurs en ordre rangé avec des petits pas sautés, dans une marche quasi militaire appuyée par des poses martiales de porteurs de piques ou d’enseignes. Les contrepoints chorégraphiques dans le groupe sont très efficaces, les interprètes avançant soit par vagues soit en plus petites formations. La référence au jeu de Go, invoquée par le chorégraphe, paraît évidente.

ALL I NEED par la BEAVER DAM COMPANY, chorégraphie EDOUARD HUE, LE TEMPS D’AIMER LA DANSE. Photographie de Stéphane Bellocq.
Dans le deuxième tableau, les danseurs et danseuses, cette fois complètement habillés, développent une gestuelle globalement très mécanique ou psychotique mais également toute personnelle. S’avançant par vagues successives ils viennent quérir l’approbation du public. Même fractionné, le groupe semble toujours soudé jusque dans les épisodes de conflits. Un grand gaillard tombe de scène. Pour surmonter sa gêne, il se lance une fois remonté sur le plateau dans une série d’improbables impros mi-cuites. L’ambiance semble être à la farce. Mais après qu’un type longiligne a réclamé moult fois des applaudissements pour lui et pour la troupe, le climat de la pièce bascule.
Lors d’une scène à la puissance quasi-insoutenable, une fille poussée sur le devant de la scène essaye de prendre la parole. Elle murmure « bonjour » mais l’idée de s’adresser au public provoque des spasmes de tout le corps ; des torsions et des oscillations du tronc au-dessus des jambes qui paraissent impossibles à force de défier la gravité.
Après cette scène pour le moins frappante, All I Need, s’étiole quelque peu. Edouard Hue ne parvient pas vraiment à pousser l’intensité de sa pièce au-delà de cet épisode traumatique. Le tableau de « Make America Safe Again » (un danseur mime cet extrait de discours répété en boucle tandis que son costume est déchiré au fur et à mesure par les autres danseurs affublés d’oripeaux divers et improbables) traine un peu en longueur et a un petit air de déjà-vu. On n’échappe pas non plus à la scène « de l’Enfer de Dante » où les danseurs se contorsionnent au ralenti en poussant des cris muets ; un des poncifs chorégraphiques de notre époque.
Edouard Hue a les grandes qualités mais aussi les travers de sa génération qui s’enivre de la puissance de sa gestuelle mais oublie trop souvent la nécessité d’éditer et de couper ce qui est redondant ou superflu.
On reste néanmoins confiant en son avenir de chorégraphe et dans celui de sa belle et expressive troupe.

 « L’Histoire de Manon », Ballet de l’Opéra national de Paris. Soirée du 12 juillet 2023.
« L’Histoire de Manon », Ballet de l’Opéra national de Paris. Soirée du 12 juillet 2023.














 Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.
Dans les ballets de Maurice Béjart, il n’y a jamais eu, de l’aveu même du chorégraphe lui-même, grand-chose de novateur en termes de technique. Comme souvent, les grands moments de renouveau dans le monde du ballet ne se jouent pas sur le dépassement des limites physiques de cet art mais sur un nouvel éclairage ainsi que sur des métissages réussis. Balanchine a exploré et poussé à l’extrême le ballet symphonique déjà en germe dans la Belle au bois dormant de Tchaïkovski-Petipa tandis que Lifar poussait à ses limites les volutes décoratives des Ballets russes. Plus tard, Forsythe a ajouté la structure en boucle des enchaînements ainsi que des départs de mouvements inspirés de la kinésphère labanienne au vocabulaire du ballet.




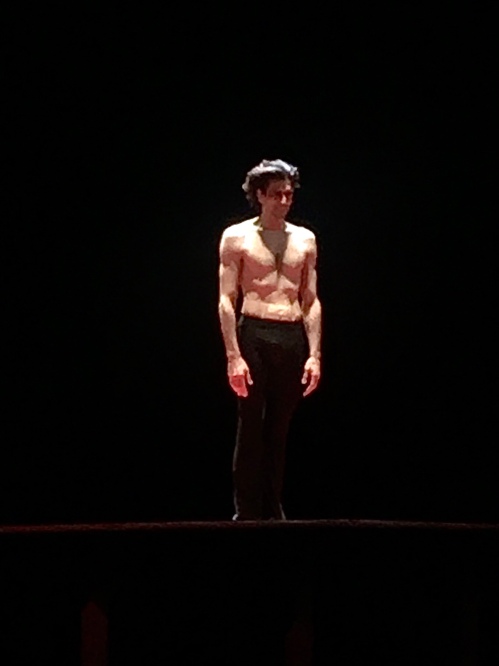

 Londres. Royal Opera House. Cinderella (Ashton / Prokofiev). Nouvelle production 2023 (Tom Pye Décors/ Alexandra Byrne Costumes/ David Finn Lumières / Finn Ross Video designer) Représentation du dimanche 16 avril 2023.
Londres. Royal Opera House. Cinderella (Ashton / Prokofiev). Nouvelle production 2023 (Tom Pye Décors/ Alexandra Byrne Costumes/ David Finn Lumières / Finn Ross Video designer) Représentation du dimanche 16 avril 2023.