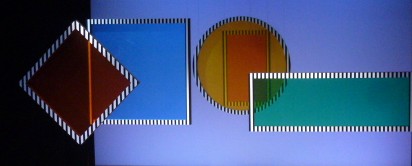George Balanchine (et hommage à Violette Verdy), Ballet de l’Opéra national de Paris. Représentation du 27 octobre 2016, palais Garnier.
George Balanchine (et hommage à Violette Verdy), Ballet de l’Opéra national de Paris. Représentation du 27 octobre 2016, palais Garnier.
« Muse », un mot qu’on associe aisément à George Balanchine. Son premier authentique coup d’éclat ne fut-il pas Apollon Musagète, juste avant le démantèlement des ballets russes en 1929 ? Par la suite, le chorégraphe jalonna sa longue carrière d’une série de danseuses que, Pygmalion contemporain, il façonna, qui l’inspirèrent et qu’il épousa, parfois.
Telle qu’elle se présente en ce mois d’octobre, avec l’addition de Sonatine (1975), en hommage à Violette Verdy disparue en février dernier, la soirée que le ballet de l’Opéra consacre au chorégraphe fait réfléchir à ce thème hautement apollinien.
Sonatine est introduit par un montage d’archives intelligent et sensible de Vincent Cordier, montrant en quelques minutes, la bonté, la force et l’humour de la femme et l’incroyable musicalité de la danseuse (même avec des extraits muets). Le ballet qui fait suite à cet hommage filmé est un dialogue entre la musique de Ravel et un couple de danseurs qui y trouve son ciment. C’est une conversation en musique où l’idiome classique est parfois subrepticement interrompu par des humeurs jazzy, des facéties inattendues comme lorsque le danseur saute, gigote les jambes repliées en l’air et retombe à genoux. À la différence de Duo Concertant (1972) qui répond au même principe (un couple, un piano à queue), les danseurs ne passent pas leur temps à regarder le pianiste, mais ils en font un des protagonistes du ballet. Myriam Ould-Braham et Mathias Heymann servent à merveille ce bijou d’humeur et d’humour. Il a ce côté élégant et facétieux (parfois à la limite de la perte de contrôle) qui contraste et va bien à la fois à cette partenaire élégante (jusque dans les tacquetés jazzy) et assurée mais à l’indéfinissable fragilité intérieure qui rend sa danse bourdonnante, frémissante, insaisissable.
L’autre muse de la soirée paraît au premier abord encore plus évidente encore que Violette Verdy puisqu’elle est à l’origine de deux des trois autres ballets du programme. Il s’agit de Suzanne Farrell. Brahms Schönberg Quartet qui occupe toute la partie centrale de cette soirée à deux entractes, une reprise de juillet dernier, culmine avec le grand divertissement « goulash » créé sur la belle et longue danseuse et Jacques D’Amboise en 1965. Entré au répertoire à Bastille, le ballet convient mieux au plateau de Garnier même si maintenant, la toile de fond avec son palais viennois semble un peu trop grande. Pour ne rien gâcher, le corps de ballet est plus à son affaire. Les lignes ont gagné en pureté et les trios de filles des deuxième et troisième mouvements en l’homogénéité. C’est le troisième mouvement surtout qui bénéficie le plus de ces changements. Mélanie Hurel cisèle sa partition et Arthus Raveau fait un exercice de précision comme en juillet dernier mais notre attention reste soutenue là où elle s’effilochait jadis. Le fameux mouvement tzigane de Farrell dans lequel Balanchine semble avoir mis toute son énergie est une planche savonnée. Malheur à qui en fait trop ou pas assez. Le couple pour cette soirée est délicieux. Alice Renavand, alternant le tendu et le relâché, bacchante déliée, minaude avec esprit. Josua Hoffalt, technique précise, développés bas et pesants, bras « avides », cabotine avec humour et gourmandise.
Mais toutes ces qualités d’interprétation ne sauvent néanmoins pas ce ballet qui garde les mêmes qualités et les mêmes défauts qu’on avait notés à la fin de la saison dernière : Balanchine se cite abondamment et ne crée rien de vraiment nouveau ni de mémorable.
Mozartiana, la seule entrée au répertoire de ce programme, est encore plus lié à Suzanne Farrell que ne l’est Brahms-Schoenberg. Dans cette œuvre testament de 1982, Balanchine réorganise les numéros de la partition de Tchaikovsky afin de commencer par un lever de rideau mélancolique où la ballerine principale, tout de noir vêtue, entourée de quatre gamines de l’école de danse dans le même attirail, mime une prière funèbre. Le reste du ballet est un mélange de joliesses et de préciosités techniques qui regardent à la fois du côté de la danse baroque et de l’école de danse danoise. Après la prière, l’humeur change par exemple très – voire trop- vite avec la gigue exécutée par le demi-soliste masculin. François Alu, étonnamment terrestre, y figure une sorte de polichinelle sorti de sa boîte mais dont les ressorts n’auraient pas suffisamment été remontés. À aucun moment sa présence ne fait sens dans le ballet. Dorothée Gilbert écope du rôle créé par Farrell. Elle a des équilibres suspendus, des bras exquis, une taille souple et déliée. Son partenaire, Josua Hoffalt, caresse le sol du pied avec délicatesse, tourne et bat avec élégance, précision et une pointe de panache bienvenue.
Les pas de deux réservent de jolies surprises avec les épaulements inattendus des rattrapages de pirouettes en dehors au vol. Mais cette addition de rencontres est sans tension interne. Cela dure et cela lasse comme d’ailleurs la musique de Mozart réorchestrée par Tchaïkovski. On peut comprendre l’importance historique de ce ballet pour le New York City Ballet (c’est la dernière œuvre composée par le maître) et son maintien au répertoire dans cette compagnie. Mais sa transplantation à Paris s’imposait-elle vraiment ?
Car il y a un paradoxe lorsqu’on aborde le cas de Suzanne Farrell en tant que muse. Quand on y regarde de plus près, on remarque qu’aucune des chorégraphies que le maître a créées pour elle n’est tout à fait à la hauteur du reste de sa production. Mozartiana est le cousin pauvre de Square Dances (1957), Brahms-Schöneberg pâlit devant Liebeslieder Walzer (1960), Diamonds est l’un des plus beaux pas de deux de Balanchine mais la véritable gemme de Jewels (1967) est le ballet Rubies. Cette danseuse exceptionnelle semble avoir brouillé les qualités de chorégraphe arrivé à l’automne tardif de sa vie d’homme. Balanchine passe son temps à mettre en scène sa muse en vierge (éplorée dans Mozartiana) ou en bacchante (Brahms-Schönberg, Tzigane) et parfois les deux ensembles comme dans son Don Quichotte (1963), dont il dansa parfois le rôle-titre à ses côtés. Dans sa biographie, Holding On To The Air, Suzanne Farrell indique qu’Ib Andersen plutôt que Peter Martins avait été choisi pour être son partenaire dans Mozartiana car ce danseur présentait une similitude physique avec Mr B : « En ce sens, Mozartiana était notre dernière danse. Il n’y avait pas de remplaçant ».
Une telle effusion de pathos n’est pas le point de départ idéal pour créer un grand ballet.
Violin Concerto qui termine la soirée Balanchine à l’Opéra illustre cette théorie en creux. Le ballet a en effet été créé en 1972, sans Suzanne Farrell ; et pour cause. Elle avait été rayée de rangs de la compagnie pour avoir osé se marier en secret à un des danseurs du New York City Ballet. Privé par ses propres soins de sa muse, Balanchine dut se tourner vers des danseuses placées moins haut dans son cœur et dans son firmament chorégraphique. Et voilà qu’il créa un nouveau chef-d’œuvre.
Cet opus Black & White sur la partition de Stravinsky qui pourrait faire penser à un Agon humoristique est, comme Brahms-Schönberg Quartet rempli de danses d’inspiration tzigane. Mais ici, elles apparaissent de manière inattendue. Durant le final, la danse russe laisse la place à une sorte de charleston.
À la différence de Mozartiana, l’usage du corps de ballet n’est pas qu’accessoire. Chacun des quatre solistes est accompagné d’un quatuor. Au début, les filles apparaissent avec les solistes masculins et à l’inverse, les garçons accompagnent les solistes féminines. Cette configuration s’inverse ensuite. Les quintets dévorent en tous sens l’espace scénique. De même, les pas de deux, dont nous nous sommes sentis abreuvés dans les deux œuvres précédentes, ont ici chacun une couleur et une histoire.
Le premier est un combat, une sorte de Chat botté et Chatte blanche contemporain. Le violon feule et les danseurs se repoussent de la hanche avant de s’enrouler sensuellement l’un autour de l’autre. Cela convient bien à Hugo Marchand, impressionnant de bout en bout avec ses arabesques faciles, sa précision et sa projection dans l’espace entre carreau d’arbalète et boulet de canon. Marie-Agnès Gillot, moins convaincante dans le mouvement d’ouverture, accorde et encastre en revanche parfaitement ses grands abatis dans ceux de son partenaire. Pour le second pas de deux, qui est une élégie, la danseuse, étirée en tous sens par son partenaire, a un petit côté madone de douleurs mais dans une forme sublimée plutôt qu’appuyée comme dans Mozartiana. Cette qualité touchante manque cruellement à Eleonora Abbagnato qui, ces dernières saisons, danse de manière trop délibérée. On apprécie néanmoins les lignes qu’elle forme avec Audric Bezard, au parfait sur tout le ballet, avec sa présence mâle et un tantinet menaçante.
Ce regret n’affaiblit pas le plaisir qu’il y avait à revoir cette œuvre, entrée au répertoire du ballet de l’Opéra en 1984, où Balanchine oublie de jouer le Pygmalion et retrouve enfin sa muse.











 Soirée Peck-Balanchine : samedi 2 juillet 2016.
Soirée Peck-Balanchine : samedi 2 juillet 2016.
 Cela commence un peu comme une garden party avec 4 trios de danseurs et un tercet de solistes. On sent quelques réminiscences de « La Valse » ou de « Liebeslieder Walzer ». L’ensemble paré de rayures noires et blanches très Sécession viennoise est mené par Sabrina Mallem aux jetés pleins d’autorité, aux côtés d’un quatuor de garçons, et un couple élégamment tournoyé par Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio. Le formalisme des danses est accentué par l’interprétation un peu détachée des deux principaux solistes.
Cela commence un peu comme une garden party avec 4 trios de danseurs et un tercet de solistes. On sent quelques réminiscences de « La Valse » ou de « Liebeslieder Walzer ». L’ensemble paré de rayures noires et blanches très Sécession viennoise est mené par Sabrina Mallem aux jetés pleins d’autorité, aux côtés d’un quatuor de garçons, et un couple élégamment tournoyé par Dorothée Gilbert et Mathieu Ganio. Le formalisme des danses est accentué par l’interprétation un peu détachée des deux principaux solistes.




 Palais Garnier, lundi 7 décembre
Palais Garnier, lundi 7 décembre