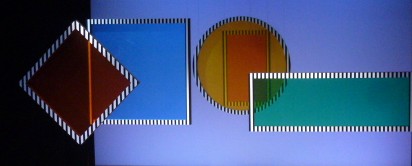Les Balletonautes n’ont pas boudé les représentations du programme Rr (ROBBINS-Ratmanski). Ils ont réussi à voir trois dates différentes entre le 23 juin et le 7 juillet (une quatrième a été annulée en raison de la journée de soutien aux intermittents). Voilà les résultats d’une conversation tenue sous un clair de lune entrecoupé d’averses, non loin de la grande Boutique….
Les Balletonautes n’ont pas boudé les représentations du programme Rr (ROBBINS-Ratmanski). Ils ont réussi à voir trois dates différentes entre le 23 juin et le 7 juillet (une quatrième a été annulée en raison de la journée de soutien aux intermittents). Voilà les résultats d’une conversation tenue sous un clair de lune entrecoupé d’averses, non loin de la grande Boutique….
Cléopold (à la barbe fleurie d’aise) : « Ma foi, comme lors de la dernière reprise, je n’aurai vu qu’une représentation mais c’était la bonne ! (se rembrunissant) Enfin, presque….. James ! Cessez de sautiller comme ça vous me donnez le mal de mer ! »
James : « tut ! tut ! Cléo. (se calmant enfin) Mais j’en conviens, la première distribution, celle du 23 juin, la distribution « 5 étoiles » était supérieure à celle « 5 premiers danseurs » que j’ai vue le 29.
Fenella : « James, seriez-vous devenu snob ? »
Cléopold : « Et puis ils n’étaient pas 5 ; ils étaient 6… »
James : « que nenni Fenella ! Cléopold, vous êtes psychorigide…. La différence principale entre la distribution « cinq étoiles » -j’insiste !- … du début de la série et la « 5 premiers danseurs » du 29 juin est que la première faisait confiance à la danse, alors que la seconde semblait vouloir montrer qu’elle avait compris l’histoire. »
Fenella : « J’ai tout de même trouvé le cast du 23 un peu jeune, comparé aux créateurs new yorkais et londonien des années 70… Par exemple, quelque chose manquait dans la première rencontre du danseur en vert et de la danseuse en jaune. Ce duo est un vrai challenge, (rougissant) syncopated, i would say… Excuse my french. Ce doit être du « attrape-moi si tu peux ! ». Eh bien Nolwenn Daniel envoyait les bons signaux mais Josua Hoffalt semblait un peu long à la détente. L’effet comique languissait un peu…
Cléopold : « Vraiment Fenella ? Mais j’ai beaucoup aimé le danseur vert d’Hoffalt… Il a le grand jeté…, comment dire (pause) … viril… Et Nolwenn Daniel… est à la fois incisive et déliée. »
James (approbateur) : «J’ai trouvé délicieux Hoffalt en vert. Dans le pas de deux avec la danseuse jaune de Nolwenn Daniel, ils avaient tous les deux des bras qui flottaient au vent – leurs agaceries étaient celles d’adultes qui badinent, avec une certaine distance au rôle. Muriel Zusperreguy et Pierre-Arthur Raveau, le 29, donnaient à voir des adolescents qui mettaient tout leur cœur dans l’enjeu.»
Fenella : «J’ai vu Raveau avec Eloïse Bourdon là-dedans. Elle était solaire et trompe-la-mort. Elle semblait avoir fait les quatre cent coups avec tous les gars du groupe depuis l’enfance.»
Et Hoffalt ! (s’arrêtant soudain)… « Comme c’est drôle, je me plaignais tout à l’heure d’avoir trouvé la 5 étoiles trop « jeune » et je me rends compte que j’ai adhéré à une plus jeune encore… (Reprenant) Hoffalt… Je pense qu’il a conquis le public dès sa première entrée en Brun avec sa lumière, sa précision et son approche très joueuse avec la musique. Pas un poète cherchant après sa Sylphide, juste un gars voulant passer du bon temps avec des amis chers. »
James : « Il ne m’a pas tant séduit en brun. Sans doute la poésie de Ganio me manque-t-elle. Le danseur à la mèche danse avec une élégance teintée de caractère. Chez Hoffalt, le dosage est dans l’autre sens. »
Cléopold : « J’adore les courses inspirées de Ganio. Quand il court, il a toujours l’air d’être dans le monde des idées ! Et ma foi, quel joli couple avec la danseuse rose de Pagliero ! »
James (très docte) : « Elle a pour elle la fluidité, la finesse des accents, et sait placer certaines inflexions cruciales comme si elle touchait elle-même le piano. »
Cléopold : « Vous avez raison, sa danse est un délice de moelleux (posant puis ajoutant) même si sa présence apaisante atténue une partie du drame sous-jacent entre le danseur mauve et le danseur brun. »
James : « Dans le partenariat rose/violet, on regarde surtout Pagliero et un peu Paquette ; en revanche le 27, on scrutait autant Albisson que Bézard, car ce dernier, qui danse toujours racé, est expressif même du dos »
Fenella : « Bézard ? Il m’a fait penser à Gregory Peck dans Spellbound et Roman Holiday…he may look the part but never turns out to be quite what you expect…Sa façon de marcher sinueusement autour de la vert amande comme Gros Minet autour de Titi m’a donné des frissons.»
(rires)
«Pour ce qui est d’Albisson, personnellement, Je l’ai trouvée un peu verte dans la mauve…»
(Cléopold lève un sourcil et se tripote la barbe)
Fenella : « Je veux dire… un peu jeune… (en aparté) Damn ! »
Cléopold : « Moi, Je l’ai trouvée très juste. Lorsqu’elle s’agenouille devant le danseur vert, elle sait installer son petit mystère. Elle a ce qu’il faut de réserve romantique… Et c’est curieux comme ses lignes s’accordent mieux avec Hoffalt lorsqu’elle ne porte pas de tutu »
Fenella : « Eh bien moi, j’ai préféré la mauve de Laura Hecquet : un peu sèche mais sans raideur. On aurait dit la fille qui a juste un an de plus que les autres et qui a quelques préoccupations qui leur sont encore étrangères…»
James (recommençant à gesticuler) : « Albisson en mauve est incomparable par rapport à Colasante, qui manque de grâce et d’abandon. »
Fenella (taquine) : « calmez-vous, James… sinon que ferez-vous si je vous dis que j’ai beaucoup aimé la danseuse en rose d’Albisson que vous goûtez moins ; Son habituel mélange de mouvement mené à fond et de relaxation, de crémeux sans excès…
(Changeant de sujet) … Mais au fond, ce qui était beau dans mes deux soirées, et surtout dans la dernière sur 7 juillet, c’était l’accord entre les danseurs… Au-delà de l’âge ou du rang hiérarchique. »
James : « Exactement, voyez Giezendanner. Eh bien dans le trio avec Pagliero et Albisson, les trois donzelles créaient une émotion profonde quand elles virevoltent de concert. J’ai peut être été moins chanceux sur ma deuxième distribution. Le trio Albisson-rose, Colasante, Granier, était bien moins touchant. De même pour le danseur brique, Emmanuel Thibault … ».
Cléopold (l’interrompant; exalté) : « Un miracle de juvénilité bouclée ! »
James (aggacé) : Vous m’interrompez encore… « Juvénilité bouclée »… Prenez garde, Cléopold, vous allez bientôt vous mettre à parler de (ton affecté) la joie de danser des danseurs… Je reprends. Emmanuel Thibault coule ses agaceries dans le flux du mouvement avec Mlle Daniel là où François Alu joue la poursuite de la danseuse jaune de façon plus ostentatoire – et il accentue aussi trop ses épaulements.
(Changeant de sujet) Mais je pense que nous allons tomber d’accord sur la danseuse en vert amande.
Cléopold et Fenella (de concert) : « agrrh ! »
Cléopold (véhément) : « Là ou jadis Claude de Vulpian marquait joliment sa première variation -une Taglioni des temps modernes !- Aurélie Dupont surligne et démontre. Et dans la deuxième entrée avec les membres masculins de la distribution c’est encore pire ; Elle ne badine pas, elle babille. Pire! Elle caquette ! J’avais envie de crier Chut !… »
James : « Vous n’aimez pas Dupont en vert ? Mais Sabrina Mallem ne convainc pas entièrement non plus. Elle ne manque pas d’intéresser lors de sa première apparition, en dansant entre les notes, et par le côté lunaire que lui donnent ses grandes articulations caoutchouc. Mais par la suite – faisons abstraction d’une petite chute –, sa parade est plus rentre-dedans que chic, et elle termine – comme chez Dupont – par un haussement d’épaules trop appuyé. Peut-être sont-ce les maîtres de ballet qui coachent avec du Stabilo. »
Cléopold : « pour la seule danseuse en vert amande ? A ce stade de sa carrière, future maîtresse de ballet, la demoiselle devrait avoir dépassé le stade du copié-collé d’interprétation….»
Fenella: c’est un soupir, pas un haussement d’épaules! Je dois le dire en Anglais … The point is to raise the shoulders only slightly but then really exhale from your core and let the shoulders drop with your breath. Your little hands and wrists, the only part of your upper body that are still « up » at that instant, then will express « oh well » rather than « so what.«
Cléopold (reprenant) : Quant à Mallem, elle est sans doute un peu « jeune » –entendez pas assez distribuée le reste du temps– pour un tel rôle, non? Je l’aurais plutôt vue dans la mauve et en tout cas, la bleue… »
James : « Pour moi, la bleue, c’est Charline Giezendanner, la petite sujette à la danse perlée… »
Cléopold : « … perlée, fuitée, et au joli son de flûte à bec… Et Duquenne ! Ses portés dans le sextuor sur la grande valse brillante ! La gradation d’intensité avec laquelle il rattrapait et faisait tournoyer la danseuse mauve, la rose puis enfin la jaune a fait s’exclamer la salle le soir où j’y étais…
Fenella : « Le soir de ses adieux, c’était exactement le même, (se reprenant) sorry, pareil. Quel rattrapeur, ce Duquenne! Cela me rappelle cette série de Roméo et Juliette où il était Benvolio presque tous les soirs et où il rattrapait tous ces Roméo de tailles et corpulences diverses qui se jetaient dans ses bras à la renverse. Il a le timing d’un grand joueur de baseball qui n’a pas l’air d’y être, ni de s’attendre à quoi que ce soit mais qui soudain a des aimants sur les mains…. »
Cléopold : « Et en tant que danseur, il était tellement plus que cela… Son Roméo ! »
Fenella (reprenant) : « A la fin du ballet, lorsque les danseurs se préparaient à sortir de scène, les hommes s’inclinent devant les femmes. Déjà isolé sur le devant de scène, côté jardin, il a été le seul à placer sa main sur son cœur, comme s’il disait adieu.»
[un ange passe et s’en va]
Cléopold : « Bon… je m’agenouillerais bien pour toucher le sol… mais nous ne sommes pas dans un parc bucolique mais bien sur l’asphalte parisien… »
James : « Vous avez raison, il est temps de se séparer »
Fenella (citant Ruskin et Keats de mémoire) :
« The purest and most / Thoughtful minds are / Those which love colour / The most. »
*
* *
« Heard melodies are sweet / But those unheard are / Sweeter »
[La lune se cache et le ciel vomit des torrents d’eau]
Soirée du 23 juin : Mathieu Ganio (brun), Nolwenn Daniel (jaune), Josua Hoffalt (vert), Ludmila Pagliero (rose), Karl Paquette (violet), Charline Giezendanner (bleu), Christophe Duquenne (bleu), Amandine Albisson (mauve), Aurélie Dupont (vert), Emmanuel Thibault (rouge brique).
Soirée du 29 juin : Josua Hoffalt (brun), Muriel Zussperreguy (jaune), Pierre-Arthur Raveau (vert), Amandine Albisson (rose), Audric Bezard (violet), Christelle Granier (bleu), Nicolas Paul (bleu), Valentine Colasante (mauve), Sabrina Mallem (vert), François Alu (rouge brique).
Soirée du 7 juillet : Josua Hoffalt (brun), Héloïse Bourdon (jaune), Pierre-Arthur Raveau (vert), Amandine Albisson (rose), Audric Bezard (violet), Laurène Lévy (bleu), Christophe Duquenne (bleu), Laura Hecquet (mauve), Aurélie Dupont (vert), Daniel Stokes (rouge brique).
 La Bayadère, Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du mardi 24 novembre 2015.
La Bayadère, Ballet de l’Opéra de Paris. Soirée du mardi 24 novembre 2015. La Gamzatti de Valentine Colasante est dans la veine des princesses altières et cruelles. Dans sa scène de confrontation, elle savoure chacune des humiliations infligées à sa rivale et triomphe lorsque la danseuse sacrée lâche au sol son poignard.
La Gamzatti de Valentine Colasante est dans la veine des princesses altières et cruelles. Dans sa scène de confrontation, elle savoure chacune des humiliations infligées à sa rivale et triomphe lorsque la danseuse sacrée lâche au sol son poignard. C’est la question qui reste en suspens durant tout le troisième acte. Amandine Albisson, qui semble avoir surmonté enfin la « malédiction du plateau » (mis a part quelques développés à la seconde un peu timides), déploie ses lignes et semble enfin danser sans penser « je suis trop grande pour porter ça ». Elle est belle et digne. Solor-Hoffalt, continue sur le thème du remord. Il rentre les épaules dès que son apsara évanescente pose le regard sur lui. Mais cela parle-t-il d’amour ? Durant tout l’acte, Hoffalt reste désolé et Albisson … belle et digne ; chacun dans sa sphère. Au moins Albisson est-elle agréable à regarder. Car Josua Hoffalt confirme décidément qu’il n’est pas à la hauteur du challenge technique de cette « Bayadère ». Il cochonne la plupart des pirouettes de la coda et escamote une fois encore les doubles assemblés du manège pour les remplacer par des coupés renversés tout rabougris.
C’est la question qui reste en suspens durant tout le troisième acte. Amandine Albisson, qui semble avoir surmonté enfin la « malédiction du plateau » (mis a part quelques développés à la seconde un peu timides), déploie ses lignes et semble enfin danser sans penser « je suis trop grande pour porter ça ». Elle est belle et digne. Solor-Hoffalt, continue sur le thème du remord. Il rentre les épaules dès que son apsara évanescente pose le regard sur lui. Mais cela parle-t-il d’amour ? Durant tout l’acte, Hoffalt reste désolé et Albisson … belle et digne ; chacun dans sa sphère. Au moins Albisson est-elle agréable à regarder. Car Josua Hoffalt confirme décidément qu’il n’est pas à la hauteur du challenge technique de cette « Bayadère ». Il cochonne la plupart des pirouettes de la coda et escamote une fois encore les doubles assemblés du manège pour les remplacer par des coupés renversés tout rabougris.