Coppélia (Musique Léo Delibes. Chorégraphie Jean-Guillaume Bart. Ballet du Capitole de Toulouse. Représentations du 22, 23 et 24 avril 2025).

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Photographie David Herrero
Coppélia est l’unique ballet français qui a connu une transmission sans interruption dans sa compagnie d’origine. Tous les autres grands classiques nés en France et surtout à Paris aux XVIIIe ou au XIXe siècle, tels La Sylphide ou Giselle, pour ne parler que des plus mythiques, sont soit des reconstructions soit des retours tardifs par le prisme russe.
En France, les professionnels de la danse ont tristement l’habitude de penser qu’un ballet, lorsque les créateurs et interprètes de transmission directe de l’œuvre ont tous disparu, ne vaut plus la peine d’être repris et qu’il faut repartir à zéro. Il y aussi une petite forme de condescendance qui les pousse souvent à penser que les danseurs d’aujourd’hui, plus avancés techniquement, vont s’ennuyer à danser les pas du passé. Fort heureusement, ni les russes ni les anglo-saxons n’appliquent ce théorème mortifère à leur propre répertoire.
Je suis bien conscient que l’ensemble d’une chorégraphie ne peut rester intacte avec le temps mais une approche à la Rudolf Noureev, conservant ce qui est devenu traditionnel dans une chorégraphie (même si tout n’est pas originel) et comblant les blancs (souvent des passages pantomimes) avec ses propres chorégraphies, me paraît la plus fructueuse.
Dans la Coppélia parisienne, les passages dansés de Swanilda chorégraphiés par Saint-Léon ont fait a priori l’objet d’une transmission ininterrompue. À l’acte 2, la scène de la poupée est un petit chef-d’œuvre avec la ballerine qui secoue les bras de manière cadencée tout en faisant des piétinés à reculons comme si son balancier régulateur d’automate s’était déréglé. Certes, les danses de caractère qui infusent le premier acte silésien du ballet sont un peu basiques pour un corps de ballet moderne. Quant à l’acte 3, il a disparu dans le sillage tourmenté de la guerre franco-prussienne de 1870. Cet acte, allégorique, n’apportant aucun développement à l’action, mettait en scène la discorde, la paix et la guerre : des thématiques quelque peu douloureuses après la défaite française, la perte de l’Alsace-Lorraine et les fractures civiles et sociales de la Commune.
Jean-Guillaume Bart, danseur et chorégraphe féru d’Histoire de la Danse, avait donc à mon sens un terrain de jeu suffisant pour mettre sa patte de chorégraphe sur Coppélia, tout en gardant une partie du texte original de Saint-Léon. On a été un peu déçu et circonspect au départ lorsqu’on s’est rendu compte que ce ne serait pas le cas.
Mais trêve d’esprit gâte-sauce. Ces préventions ont été vite balayées au vu de l’authentique réussite que représente cette nouvelle production de Coppélia.
*
* *

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Ramiro Gómez Samón et le corps de ballet masculin à l’acte 1. Photographie David Herrero
La Coppélia de Jean-Guillaume Bart parvient en effet, sans jamais vraiment reprendre l’original, à l’évoquer tout en l’actualisant subtilement. Les décors d’Antoine Fontaine pour l’acte 1 et 3 (la place d’un village en Silésie) sont directement inspirés des décorateurs à toiles peintes du XIXe siècle mais la jolie perspective forcée d’escaliers extérieurs très Europe centrale donne tout autant au décor une profondeur réaliste qu’une impression de vertige bien venue pour illustrer cette histoire flirtant gentiment avec le fantastique. Pour la maison de Swanilda, l’impression d’intérieur-extérieur fort réussie est renforcée par les subtils éclairages de François Menou. On n’a pas ainsi l’impression d’être face à une bâtisse de toile peinte qui tremblote dès qu’on frappe à la porte comme dans Giselle. Il y a de la vie dans cette maison, on en est certain. À l’acte 2, l’atelier de Coppélius joue également habilement sur la ligne de démarcation entre réalisme et onirisme. La pièce paraît plausible ; la fenêtre par laquelle rentre Frantz par effraction semble vraiment déboucher sur un extérieur. Mais la présence d’escaliers et de galeries dans cet intérieur vient perturber cette vision de rassurante normalité tandis qu’un aéroplane à la Léonard de Vinci ou à la Jules Verne et un immense engrenage flottant en l’air réintroduisent la dimension inquiétante et fantastique. L’Histoire et l’Histoire de la Danse ne sont jamais bien loin non plus dans cette Coppélia. L’antre de Coppélius est encadrée par des images familières du ballet romantique (La Sylphide, Giselle, Paquita, le Corsaire) de même que les costumes de David Belugo semblent étonnamment proches de ceux portés par les danseurs de l’Opéra en mai 1870.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Dans l’atelier de Coppélius. Natalia de Froberville. Photographie David Herrero
Ce jeu de citation historique est particulièrement poussé durant la scène des automates. Chacune des poupées portant de discrets mais troublantes visières de plexiglas est une évocation d’un grand ballet de l’ère romantique (Conrad du Corsaire pour le Janissaire à cimeterre, Paquita pour l’espagnole, James de La Sylphide pour l’Ecossais et une Willi de Giselle qui exécute mécaniquement les sautillés du corps de ballet à l’acte 2) et la leçon de danse de Coppélius fait ressembler Swanilda-Coppélia à une succession de vignettes extraites d’un manuel de Carlo Blasis. Mais si on y regarde bien, l’acte 1 n’est pas exempt de citations actualisées de la tradition romantique : le petit banc posé à jardin semble se référer à celui de la première scène de Giselle. Mais dans cette version d’aujourd’hui, la danseuse n’avale pas le baratin floral du tendron et lui jette même son offrande à la figure.
D’un point de vue chorégraphique, Jean-Guillaume Bart parvient, sans reprendre d’enchaînements de l’original, à évoquer les spécificités du style Saint-Léon. Travaillant souvent sur des scenarios décousus (Coppélia, écrit par Charles Nuitter, fait figure d’exception), le chorégraphe savait soutenir l’attention du public en mêlant d’une manière subtile danse et pantomime – les Italiens avaient eux tendance à séparer clairement les deux. Dans la Coppélia de Pierre Lacotte, la version historique du Ballet de l’Opéra aujourd’hui uniquement dansée par l’École de Danse, la première entrée de Swanilda où elle explique au public son dilemme depuis l’arrivée d’une nouvelle venue dans le village, est un savant entremêlement de mime et de pas. Jean-Guillaume Bart utilise le même procédé pour sa Swanilda d’aujourd’hui mais il en avait usé dès le lever du rideau avec sa procession de jeunes agriculteurs matinaux (un clin d’œil encore au début de Giselle ?) qui rentrent en mode pantomime et passent sans rupture à la danse, comme s’ils continuaient leur conversation.
En termes de technique, Bart confronte ses danseurs à toutes les subtilités et à toutes les difficultés de la danse française. Les bas de jambes sont très sollicités (avec de multiples double-ronds de jambe), la batterie est reine et les épaulements sont ciselés. À l’acte 3, Frantz exécute une combinaison de tours arabesques et de pirouettes en dedans qu’on aurait pu trouver dans un des carnets de Léon Michel, père de Saint-Léon. Swanilda exécute de petits sautillés sur pointe en attitude à l’acte 1 et une diagonale sur pointe en reculant au dernier acte presque plus dans la veine de la version Petipa qui était second maître de ballet à l’époque du règne de Saint-Léon à Saint-Petersbourg. Pendant ce même acte, l’intermède des amies de Swanilda n’est pas sans évoquer le pas de six de La Vivandière, une chorégraphie préservée par le système de notation de Saint-Léon lui-même : la sténochorégraphie.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Acte 3. Photographie David Herrero
Réglés pour un corps de ballet moins pléthorique qu’au XIXe siècle (cinq couples pour la grande mazurka), les danses de caractère réglées par Jean-Guillaume Bart ont un peps extraordinaire. Les talons crépitent, le poids au sol des danseurs nécessaire dans la czardas ne se fait jamais au détriment de l’enlevé de l’exécution. Jean-Guillaume Bart a voulu représenter un petit bourg frappé de dansomanie. Pour ce faire, il a étoffé le rôle uniquement pantomime et anecdotique du bourgmestre pour en faire un personnage à part entière, lui adjoignant une épouse aussi balletomane que lui. Et monsieur le maire est un virulent adepte de Terpsichore ! En haut de forme, au milieu de ses administrés, il détonne et conduit à la fois.
*
* *
Alexandre De Oliveira Ferreira donne à ce personnage d’édile toute son énergie solaire (les 22 et 24 avril) aux côtés de Georgina Giovannoni tandis que le 23, Minoru Kaneko et Solène Monnereau nous transporteraient presque pendant l’acte du mariage au bal du Moulin rouge. Avec ses bottines, ses bas rouges et son énergie explosive, Monnereau évoque Jane Avril, la Mélinite, et Kaneko serait son Valentin le désossé survolté.
On apprécie cet enrichissement des rôles d’arrière-plan du ballet qui se sont affadis au XXe siècle avec la simplification parfois outrancière des rôles pantomimes. Bart donne du relief à la théorie des petites amies de Swanilda en développant l’interprétation d’au moins deux d’entre-elles. Sofia Caminiti est ainsi la meneuse qui donne les idées mais qui les fait exécuter par d’autres et Nina Queiroz est inénarrable en peureuse qui claque des genoux et tombe dans les pommes.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Rouslan Savdenov (Coppélius) et Natalia de Froberville (Swanilda). Photographie David Herrero
Le grand rôle secondaire du ballet, Coppélius, s’il reste principalement mimé est néanmoins développé par Jean Guillaume Bart. Dans le programme, Coppélius est désigné comme un « vieux maître de ballet exilé ». Des trois Coppélius qu’il nous a été donné de voir, c’est peut-être Rouslan Savdenov le 22 mars qui nous a semblé remplir le mieux ce cahier des charges spécifique. À l’acte 1, lorsqu’il sort la première fois de sa maison, Savdenov évoque avec sa posture un peu voutée et compacte le Jules Perrot des classes de danse de Degas. À l’acte 2, dans son antre, avec sa grande blouse et son bonnet vissé sur la tête, il évoquerait plutôt Arthur Saint-Léon.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Jérémy Leydier (Coppélius) et Kayo Nakazato (Swanilda) Photographie David Herrero
Jeremy Leydier est nécessairement très différent. Sa haute stature rend peu probable la scène où Coppelius est intimidé par les villageois. Avec sa perruque blanche, il ressemble plutôt à un élégant Frantz Liszt qu’à un maître de ballet déplumé. À l’acte deux, en revanche, Leydier sait se montrer à la fois effrayant et drôle. Lorsqu’il suit en catimini Frantz entré chez lui par effraction, il est à la fois le docteur Frankenstein et sa créature. Enfin, Jérémy-Coppélius rend totalement justice à la jolie trouvaille de Jean-Guillaume Bart pour donner de la profondeur à un acte 3 sans cela dramatiquement insipide : après la variation de Frantz sur l’Aurore, Coppélius entre avec la poupée Coppélia désarticulée sur la Prière. Leydier et sa partenaire Juliette Itou ménagent l’équilibre entre le sinistre (on ne sait pas très bien si cette Coppélia est un objet ou un corps privé de vie) et l’émouvant (le vieux savant semble faire une calme scène de la folie).

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Simon Catonnet (Coppélius) et Kayo Nakazato (Swanilda). Photographie David Herrero
Le 24 avril, dans ce passage, le Coppélius de Simon Catonnet, très Daddy Long Legs durant les deux premiers actes et fort amusant en Pygmalion effrayé qui hisse le drapeau blanc devant sa créature, évoque le mime Baptiste des Enfants du Paradis. Nino Gulordava est absolument une créature inanimée.
Ce passage explique que le début du pas de deux entre Frantz et Swanilda soit musicalement si joliment mélancolique.
*
* *

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Natalia de Froberville (Swanilda) Photographie David Herrero
Ceci nous amène tout naturellement aux rôles principaux. En trois soirées et seulement quatre danseurs, on aura finalement vu trois couples Swanilda-Frantz très différents. Le premier est en fait le seul qui avait été initialement prévu de la sorte. La distribution de la première réunissait les deux étoiles maison, Natalia de Froberville et Ramiro Gómez Samón. Froberville, toujours d’une grande légèreté dans l’exécution technique, dépeint une Swanilda au tempérament explosif. Elle querelle son Frantz avec gusto et jette en l’air sa robe de mariée avec tant de conviction que les petites amies ont du mal à la rattraper au vol. À l’acte 2, Natalia-Swanilda articule bien les moments où elle imite la poupée et ceux où elle redevient elle-même. Elle semble lancer des petits regards de connivence au public. Ramiro Gómez Samón est un Franz plus camarade d’enfance qu’amoureux. C’est un concentré de charme et d’aisance (ses entrelacés développés sont roboratifs) qui le rapproche un peu de la conception initiale du rôle de Frantz où il était incarné par une femme ; beaucoup de vaudeville mais pas tant de sentiment.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Natalia de Froberville (Swanilda) et Ramiro Gómez Samón (Frantz) Photographie David Herrero
Le 23, Kayo Nakazato remplaçait la nouvelle étoile de la compagnie, Marlen Fuerte Castro, aux côtés de Alexandre De Oliveira Ferreira. Là encore beaucoup de vaudeville. Mademoiselle Nakazato est moins volcanique dans sa colère mais plus rancunière. Dans la Czardas, elle continue à bouder son partenaire presque jusqu’à sa conclusion et durant le deuxième acte, à la réalisation de la non-humanité de Coppélia, elle est à la fois drôle et cruelle dans son imitation de la combinaison de cabrioles que faisait Frantz à l’acte 1 pour impressionner la belle lectrice installée au balcon. De Oliveira Ferreira, qui danse le Bourgmestre quand il n’est pas Frantz, tire son rôle du côté bouffon. Il n’hésite pas à montrer les côtés ridicules de son Frantz lorsque celui-ci échoue à amadouer Swanilda ou se fait prendre la main dans le sac. Sa scène narcotique à l’acte 2 est également très drôle. Il sourit béatement puis tombe raide comme une planche. Monsieur Ferreira a le don du timing comique d’un acteur du cinéma muet. Techniquement, il parcourt et bat bien. Il semble moins à son aise avec la redoutable combinaison de doubles tours arabesque suivis de pirouette en dedans de sa variation de l’acte 3. Mais, pour tout dire, Ramiro Gómez Samón l’avait quelque peu négociée aussi le 22 avant de parfaitement la réussir le 24.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse.
Alexandre De Oliveira Ferreira (Frantz). Photographie David Herrero
Car en ce soir du 24, c’est en effet Gómez Samón qui entre à Cour au premier acte. Ayant négligé de regarder la feuille de salle, on est surpris et déstabilisé. On attendait Philippe Solano qui l’avant-veille bondissait en compagnie de Gómez Samón et de Kleber Rebello dans une sorte trio-battle pour impressionner les filles. La surprise et la déception passée, on finit néanmoins par apprécier ce couple improvisé qui introduit une dimension affectueuse et romantique au couple Swanilda-Frantz.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Ramiro Gomez Samon (Frantz). Photographie David Herrero
Ramiro Gómez Samón est d’autant plus charmant en enfant penaud pris les doigts dans le pot de confiture. Kayo Nakazato, semble avoir complètement infléchi son interprétation face à son nouveau partenaire. Vraiment animée dans sa première variation (on admire la souplesse du cou et le moelleux des fouettés d’une position à l’autre), elle est touchante par les regards attristés qu’elle lance à l’épi pendant la balade du même nom. Kayo Nakazato parvient ainsi dans ce ballet si drôle à incarner une jeune fille romantique. Lorsqu’elle apparaît dans sa robe de mariée sur le perron au dernier acte, elle semble dire « eh bien vous voyez, finalement, je l’ai eu ! ». Lors du pas de deux final, on admire particulièrement ce porté discret où Frantz suspend un temps levé de Swanilda en la soutenant sous l’aisselle. Cette passe technique prend avec ce couple en particulier une signification plus profonde : il semble souligner l’état de ravissement de la jeune épousée.

Coppélia. Ballet du Capitole de Toulouse. Kayo Nakazato (Swanilda). Photographie David Herrero
Le ballet peut se terminer ensuite dans l’euphorie de la musique (à la fois gaillardement et subtilement dirigée par Nicolas André) et de la danse de caractère menée par le couple principal, les bourgmestres et le corps de ballet tout entier du Ballet du Capitole dont on aimerait pouvoir citer chacun des interprètes tant ils nous soulèvent de notre siège.
*
* *
Ainsi, si je continue à appeler de mes vœux une version de Coppélia qui sertirait les gemmes préservées de Saint-Léon sur une monture moderne, force m’est de reconnaître que je courrai revoir cette réécriture à la fois traditionnelle et moderne de Jean-Guillaume Bart dès qu’elle sera reprise à Toulouse ou bien lorsqu’elle tournera en France.















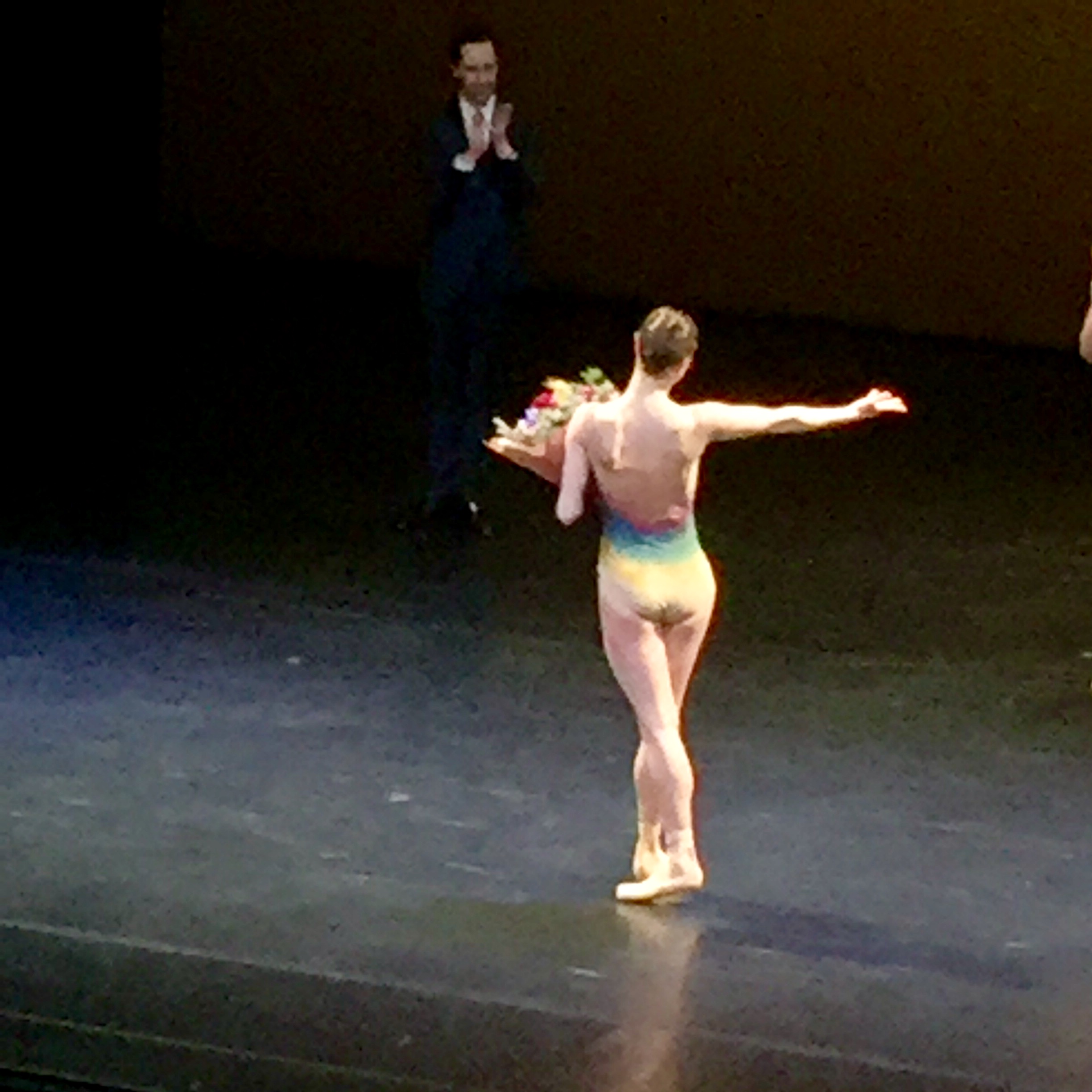














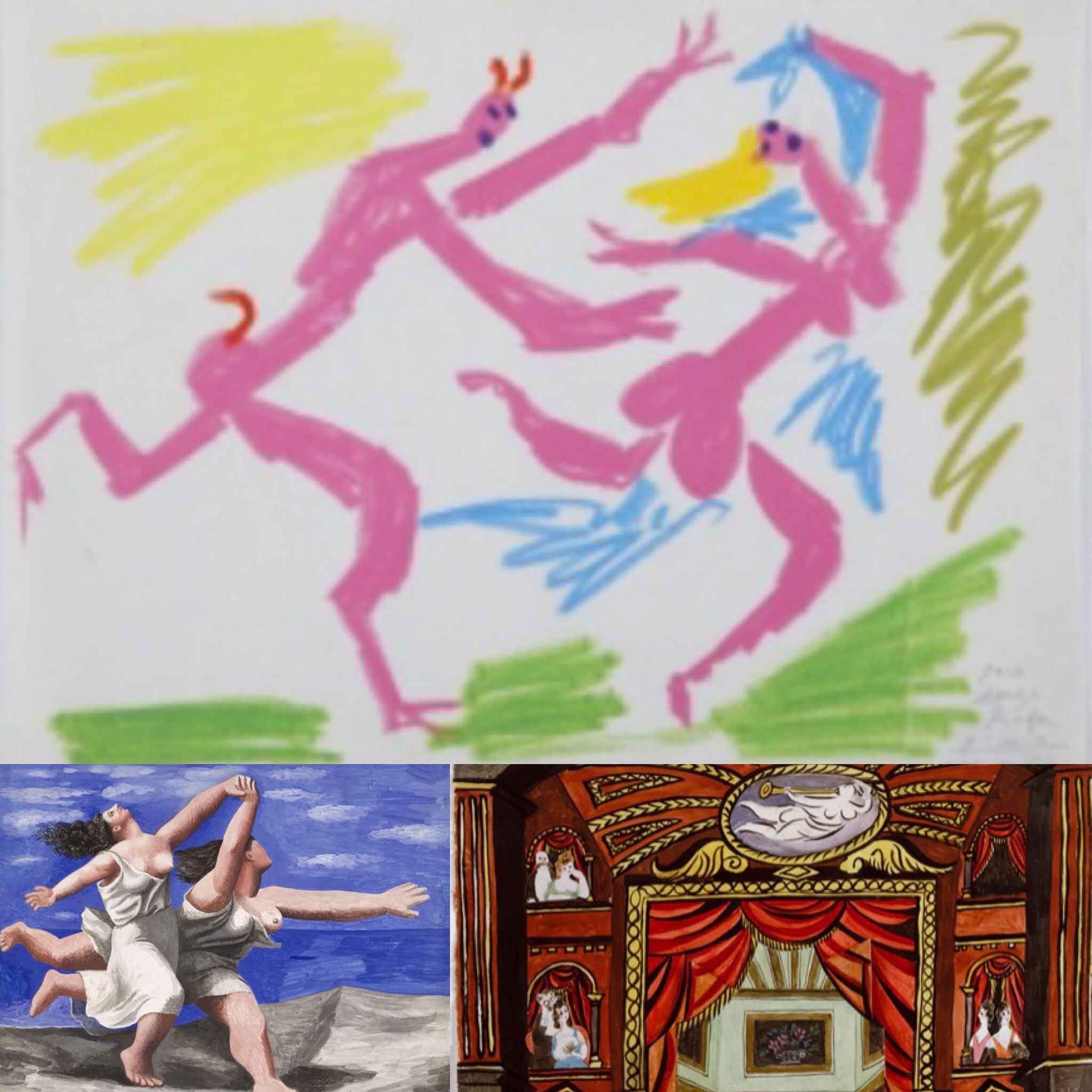 L’Après-midi d’un Faune (Honji Wang et Sébastien Ramirez / Claude Debussy et Clément Aubry, conception sonore)
L’Après-midi d’un Faune (Honji Wang et Sébastien Ramirez / Claude Debussy et Clément Aubry, conception sonore)
 Le Train bleu (Cayetano Soto / Georg Fredrich Händel)
Le Train bleu (Cayetano Soto / Georg Fredrich Händel)
 Tablao (Antonio Najarro / José Luis Montón)
Tablao (Antonio Najarro / José Luis Montón)















