Mon Premier Ballet : La Belle au bois dormant (Tchaïkovski / Fabrice Bourgeois librement inspiré de Marius Petipa). Théâtre Mogador. Dimanche 1er mars 2026.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Photographie Julien Benhamou.
Au Théâtre Mogador, la compagnie de Karl Paquette continue son travail de diffusion des grands ballets du répertoire pour un public d’âge tendre. Après les réécritures de Mon premier Lac des cygnes et Mon premier Casse-Noisette, est venu le tour du monument à la fois génial et indigeste qu’est la Belle au bois dormant. Le ballet original est constitué d’un prologue et de trois actes ainsi que d’une myriade de variations solistes qui ralentissent la narration. L’oeuvre fourmille de tellement de pages célèbres de Tchaïkovski (sans doute parce que le film animé de Walt Disney -1959- en utilisa une grande partie) qu’il est difficile de choisir ce qu’il faut garder ou écarter.
L’équation posée est difficile. On était curieux de découvrir comment Karl Paquette et ses collaborateurs s’étaient employés à la résoudre.
Et nous voilà de nouveau, comme il y a trois ans, dans l’atrium du théâtre Mogador. La boutique vend toujours un joli programme illustré, des teeshirts de ballet exclusivement roses –le public ciblé est encore très genré – et les fameuses baguettes magiques clignotantes qu’une voix off dans la salle recommande de bien laisser éteintes pendant la représentation. La salle grouille d’excitation et de bavardages même le rideau levé et lustre éteint. Cela fait partie de l’exercice. Les parents expliquent souvent le déroulé du spectacle à leur progéniture. Le balletomane s’étonne de n’être pas gêné par le babillage. Est-ce parce que, par ailleurs, les écrans de portables sont, contrairement à ce qui se passe à l’Opéra, laissés de côté ? Peut-être.
*
* *

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Karl Paquette en fée Carabosse et ses deux acolytes cat women. Photographie Julien Benhamou.
C’est sans doute aussi parce que La Belle au bois dormant est un spectacle réussi. Les deux heures trente à trois heures du ballet d’origine sont réduits à deux fois quarante minutes.
La jolie production de toiles peintes au décor néogothique (Nolwenn Cléret) regarde clairement vers l’esthétique et la narration du film de Disney : Les fées du prologue sont trois et portent les noms de Flora, Pâquerette et Pimprenelle. La scène de la piqure, qui dans le ballet d’origine a lieu devant la cour, voit ici la princesse Aurore s’échapper vers les combles du château où elle rencontre la fatale fileuse.
Les Costumes de Xavier Ronze évitent le kitsch autant que faire se peut. Et les couleurs des fées s’accordent plutôt bien avec les tons mordorés des costumes de cour.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Prologue. Le sortilège. Photographie Julien Benhamou.
D’un point de vue de mise en scène, outre le grand livre de contes dont sortent les personnages comme dans mon Premier Lac, il y a de jolies idées qui permettent, même avec un budget limité, d’évoquer le merveilleux et la magie. Des leds aux couleurs des fées s’allument dans le berceau de la jeune Aurore à chaque fin de variation et Carabosse (un Karl Paquette à la posture très mâle) enflamme la liste d’invitation de Catalabutte le majordome pour montrer sa colère. Les toiles de la forêt à l’acte 2, bien éclairées (réalisation Louis Bourgeois), sont tout à fait poétiques.
L’action coule naturellement, sans longueurs inutiles. Il n’est pas certain cependant que l’objectif ciblé « enfants à partir de 4 ans » soit atteint. Annoncer « A partir de six ans » serait plus réaliste. Et à partir de cet âge le pari est assurément gagné.
Reste le point de vue du balletomane. Quant est-il de la chorégraphie de Fabrice Bourgeois ?
Il y a de grandes qualités dans cette réécriture. La chorégraphie est musicale et exigeante. Bourgeois parvient à créer une scène des naïades avec seulement 8 danseuses de corps de ballet. La scène de la chasse donne même l’occasion aux garçons (en plus grand nombre que dans la production du Lac des cygnes) de faire une danse des Piqueurs qui n’est pas sans lancer un petit clin d’œil à Noureev avec ses temps levés double ronds de jambes en l’air.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 2. Scène du rêve. Photographie Julien Benhamou.
Pour le reste, une grande part de la chorégraphie, qui met à l’honneur les changements d’épaulement et des penchés et décalés néoclassiques, n’a souvent qu’un lien ténu avec la chorégraphie originale bien qu’il y ait néanmoins un air de famille.
On le regrette parfois. Olivia Lindon, fée en jaune, aurait très bien pu exécuter la variation originale de « canari », suffisamment courte et mignarde pour plaire aux enfants. A l’acte 1, si on apprécie au passage la composition des trois princes en concurrence, tout particulièrement Nicolas Rombaut qui a toujours eu du flair dans les rôles comiques, on trouve qu’il n’y a peut-être pas assez d’Adage à la rose dans l’Adage à la rose. La princesse Aurore se retrouve un peu abruptement à faire les équilibres finaux avec promenade quand elle n’a pas exécuté les statiques du début de la variation. La jeune danseuse, Miyu Kawamoto a donc du mal à les tenir mais se rattrape bien avec le dernier. De même, la deuxième variation d’Aurore traditionnelle et la Tarentule auraient pu s’intégrer dans les décors au lieu d’être réécrites d’une manière qui évoque plus Coppélia et ses petites amies que La Belle.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 3. Le chat botté et les chattes blanches. Photographie Julien Benhamou.
L’acte 3 est en revanche truffé de bonnes idées : la scène burlesque très réussie du tailleur affairé et du coquet Catalabutte sur la musique du défilé, la transformation du pas de deux du Chat botté en pas de trois, le pas du petit chaperon rouge féministe où Olivia Lindon manie l’osier de son panier avec autorité. L’oiseau bleu est réduit à la variation de Florine pour une danseuse sur pointe. On aurait cependant aimé que la diagonale de brisés de volée de la coda soit au moins évoqués. Les femmes peuvent en effet les interpréter avec les pointes comme le démontre par exemple les danseuses bleues du final de Soir de Fête de Léo Staats.

Mon premier ballet : La Belle au bois dormant. Acte 3. Le petit chaperon rouge. Photographie Julien Benhamou.
Les variations du pas de deux d’Aurore et Désiré sont respectées. Le prince a le physique du rôle et de jolies lignes et Miyu Kawamoto a de fort jolis ports de bras. On regrette cependant de ne pas avoir vu dans le rôle principal Philippine Flahaut, fée Lilas de cette matinée mais Aurore sur les photographies du programme, à la fois élégante, précise et suspendue.
*
* *
Au final, La Belle de la compagnie Mon premier Ballet est une expérience éminemment satisfaisante : la réussite est totale en termes de production et de narration même si la chorégraphie reste trop éloignée de l’original. Mais surtout, on salue le tour de force qui consiste à assembler une compagnie intermittente tout en créant une cohésion de groupe et une unité apparente de style.















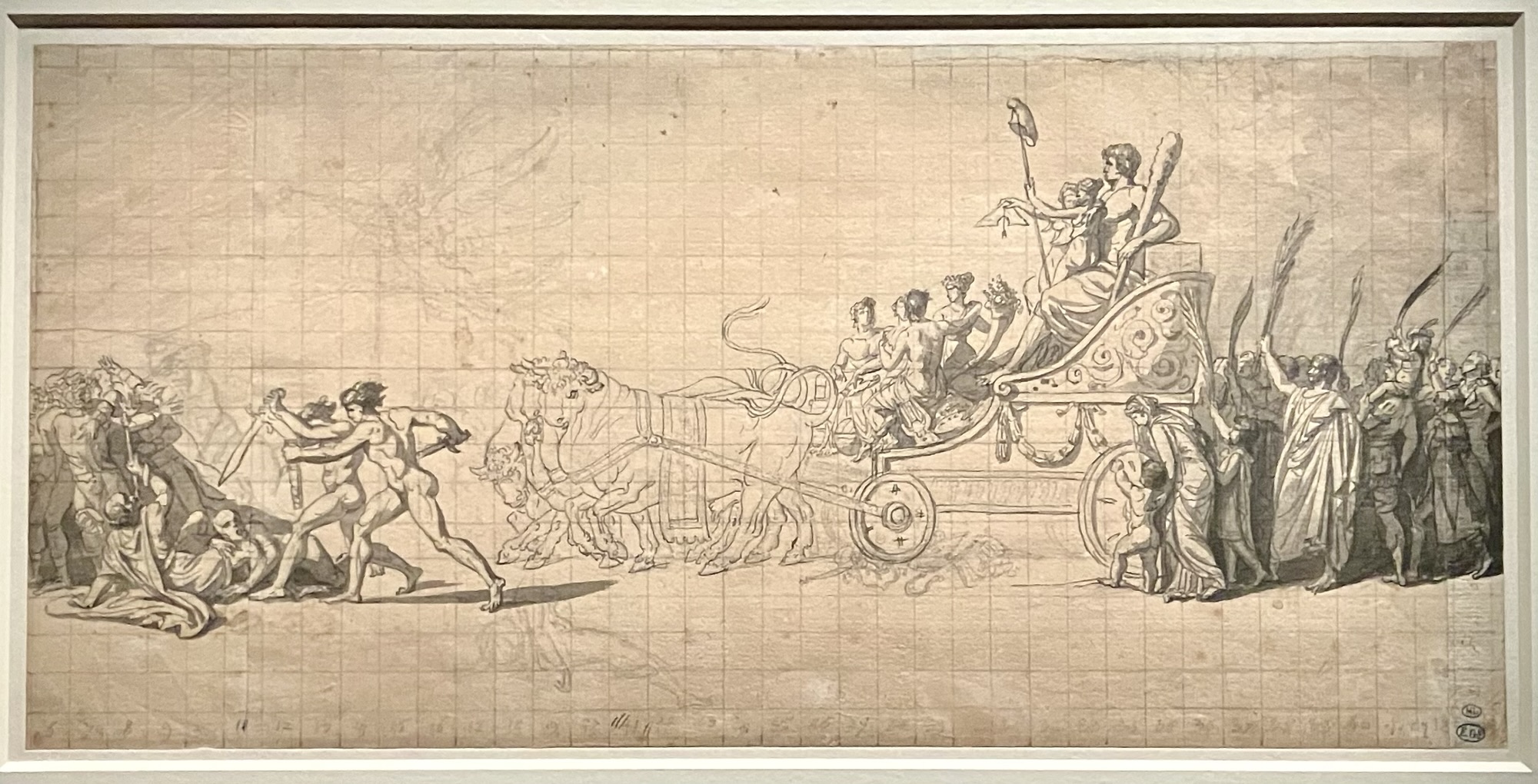
 Martha Graham 100, Théâtre du Châtelet. Soirées du 13 et 14 novembre 2025.
Martha Graham 100, Théâtre du Châtelet. Soirées du 13 et 14 novembre 2025.




















