
Photo Patrice Nin / Théâtre du Capitole
« Hommage à Ravel ». Ballet, orchestre et chœur du Capitole de Toulouse. Johan Inger, « Walking Mad ». Thierry Malandain « Daphnis et Chloé ». Représentations des 24 et 25 octobre 2025.
Pour célébrer le cent-cinquantenaire de la naissance du compositeur Maurice Ravel, le Ballet du Capitole reprend deux œuvres entrées à son répertoire sous la direction de Kader Belarbi.
*
* *

Walking Mad. Johan Inger. Aleksa Zikic et le Ballet du Capitole. Photographie David Herrero
Walking Mad de Johan Inger, reprise d’une pièce de 2001 pour le Nederland Dans Theater I, a été pour la première fois dansée en 2012 puis reprise à Toulouse en 2015 dans le programme « Et bien dansez, maintenant ! » à la Halle aux Grains. A la revoyure, la pièce garde toute sa force initiale.
Commencé dans le silence, Walking Mad oppose d’abord, dans une scène déprimante du quotidien, un homme vêtu d’un imperméable et d’un chapeau melon et ce qui semble être sa compagne, triant du linge sale jonchant le sol. Dans le fond de scène, un grand mur traverse obliquement l’espace. Cette structure à géométrie variable, mouvante et occasionnellement bruyante devient le personnage principal du ballet tandis que s’égrène la partition obsédante de Ravel.
Au début de l’exécution du Boléro, l’atmosphère est légère et loufoque. Le jeu de séduction sensuel voulu par Ida Rubinstein, la commanditaire et interprète principale du ballet à défaut d’être souhaité par le compositeur, est ici présenté de manière parodique. Un garçon en teeshirt rouge (Lorenzo Misuri au soir du 24 octobre) se fait voler son chapeau alors qu’il est placé à l’autre extrémité du mûr par une nymphette (Juliette Itou). Il entreprend ensuite de la poursuivre et peine à la rattraper. Des garçons facétieux, coiffés de cotillons pointus, apparaissent par des portes ménagées dans le mur et entreprennent des danses de séduction outrées et ridicules (mention spéciale sur les différents soirs à Philippe Solano, à Kleber Rebello, à Amaury Barreras Lapinet ou encore à Eneko Amoros Zaragoza). On pense à la version parodique du Sacre du Printemps par Paul Taylor, The Rehearsal, qui remplace le terrible sacrifice par une savoureusement stupide enquête policière.
On apprécie aussi que le mur remplace par sa verticalité l’horizontalité de la table des versions Nijinska et Béjart. Jusque à la mi-temps de la pièce, ce décor protéiforme joue le rôle de lampe merveilleuse ou de boite de Pandore, laissant s’échapper des danseurs et danseuses qui nous ébaubissent par des passes chorégraphiques subreptices et fuyantes. Une transe joyeuse avec des cris est la culmination de cette partie.

« Walking Mad ». Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Elle est stoppée net, comme l’orchestre, lorsque le mur se plie en deux pans, définissant l’angle concave d’une pièce en perspective cavalière. L’ambiance change alors du tout au tout, Une fille (Solène Monnereau le 24, Tiphaine Prevost le 25) se retrouve alors coincée dans l’angle de la pièce et trois gars, qui semblent être devenus des excroissances du mur, l’emprisonnent et la maltraitent. La musique du Boléro n’est d’abord plus qu’un vague grésillement qui sort de la coulisse. Mais, même lorsque l’orchestre recommence à jouer la partition lancinante, on comprend désormais qu’on est dans un asile de fous. Les escalades du mur, qui semblaient juste facétieuses au début, deviennent un enjeu de fuite. La transe est devenue démente. La scène de la fille qui batifolait, poursuivie par un garçon, se répète sur un tout autre registre. Elle est maintenant poursuivie par des prédateurs en trenchs-camisole.

« Walking Mad ». Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Tout cela fait-il référence à la démence qui eut raison du compositeur ? Les cliquetis métalliques du mûr sont-ils la prise en compte tardive du souhait original du compositeur, qui voulait que le Boléro représente la sortie d’ouvriers d’une usine ? L’œuvre est assurément d’une grande richesse de sens possibles.
On reste bien un peu circonspect face au choix d’Inger de terminer sa pièce avec le Für Alina d’Arvo Pärt même si elle se justifie en termes de narration. Dans cette partie au style Ekien (rendu très évident le 24 par Ramiro Gómez Samón et Kayo Nakazato), le couple initial se retrouve dans ce quotidien gris et déprimant initial qui pourrait expliquer a posteriori la folie. On est particulièrement touché par le duo du 25 octobre. Aleksa Zikic a une palette expressive étendue, passant subtilement du facétieux à l’émouvant et Georgina Giovannoni, qu’on n’avait pas encore eu l’occasion de voir se distinguer, est une interprète qui passe très assurément la rampe.

« Walking Mad ». Ballet du Capitole. Georgina Giovannoni et Aleksa Zikic. Photographie David Herrero.
*
* *

« Daphnis et Chloé ». Philippe Solano (Pan) et le Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Daphnis et Chloé vient plus tôt que Boléro dans la chronologie des partitions de ballet de Maurice Ravel : c’est en fait la toute première quand Boléro est la dernière. Dès 1909, Serge de Diaghilev avait commandé la partition au jeune compositeur pour la saison 1911. La chorégraphie était confiée à Michel Fokine qui avait souhaité travailler sur ce thème. En 1904, le jeune danseur, enthousiaste et iconoclaste, avait proposé un ballet sur ce thème à la direction des Théâtres impériaux accompagné d’un plan de réforme du ballet qui, entre-autres, proposait de jeter les tutus et les pointes à la corbeille. La direction n’avait pas donné suite à la mise en œuvre de ce Daphnis mais avait néanmoins initié une réforme des costumes. En termes d’avancées chorégraphiques, Fokine, qui entre-temps avait vu danser Isodora Duncan lors de la saison 1904, avait dû attendre 1907 pour créer un ballet sur un thème antique : Eunice, librement inspiré du roman « Quo Vadis ? » d’Henryk Sienkiewicz. Ne pouvant obtenir des danseurs qu’ils dansassent pieds-nus, il avait fait peindre des doigts de pieds sur leurs chaussons afin de faire plus naturel.
Il n’y a pas de pointes non plus dans le ballet de Thierry Malandain qui rend hommage au chorégraphe d’origine de Daphnis en évoquant certains de ses principes mais en les fondant dans sa propre gestuelle. On retrouve les poses de profil harmonieuses et non anguleuses comme celles du Faune de Nijinsky, créé la même saison, en 1912. Les pas sont glissés plutôt qu’attaqués du talon. Les rondes ont la part belle, soulignant le côté tourbillonnant de la partition du ballet. Les lignes même ont une qualité ondulatoire : au début du ballet par exemple, nymphes et bergers, tous en jupes plissés soleil vert d’eau, avancent en ligne vers le proscenium. Chaque danseur partant des extrémités vers le centre opère un quart de tour en décalé. On est invité à une célébration panthéiste …
L’un des apports majeurs de Malandain à Daphnis et Chloé est d’avoir décidé d’attribuer à un danseur le rôle de Pan qui, aussi bien dans le ballet de Fokine que dans le plus récent Daphnis de Benjamin Millepied à l’Opéra, n’apparaissait pas alors que c’est lui qui délivre Chloé, enlevée par des pirates. Il y a au passage des similitudes dans les défauts de l’argument de Daphnis et celui du ballet Sylvia, tous deux inspirés de poèmes pastoraux : les bergers y sont des tendrons impuissants.

« Daphnis et Chloé ». Philippe Solano (Pan), Kleber Rebello (Daphnis) et Solène Monnereau (Chloé). Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Dans la version Malandain, c’est un trio et non un duo qui ouvre le ballet. Daphnis et Chloé sont protégés par le dieu Pan qui préside à leurs amours tout en recevant leur hommage (la ronde des deux protagonistes, les bras en couronne écartée, autour du dieu). Au soir du 24 octobre, Philippe Solano est un peu comme une statue animée d’Eros ; à la fois sensuel mais conscient de sa condition divine. Le mouvement est ample, contrôlé et serein. En Chloé, Solène Monnereau a quelque chose de Claire Lonchampt, la muse du chorégraphe à Biarritz ; elle distille ce même genre de retrait vibrant qui la fait aimer. Kleber Rebello, Daphnis, est particulièrement émouvant dans son duo des doutes avec Lycénion (Kayo Nakazato, concentré de sensualité affirmée qui cambre du bassin avec un chic très crâne). Les courses arrêtées, le cou rentré dans les épaules, les yeux au sol, créent tout le personnage.

« Daphnis et Chloé ». Kayo Nakazato (Lycénion) et Jeremy Leydier (Dorcon). Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Une autre qualité du Daphnis et Chloé de Thierry Malandain est qu’il offre une vraie progression dramatique au couple secondaire. Pan sert de pivot entre le couple qui s’est reconnu d’emblée et celui qui ne se satisfait pas de son lot. A la fin du ballet, Malandain a créé un charmant pas de deux, très Papageno-Papagena, pour Lycénion et Dorcon, le prétendant éconduit de Chloé. Jeremy Leydier (qui avait déjà exécuté une belle variation des biscotos aux maladresses étudiées) s’y montre absolument touchant : ses rapides pas courus, son dos courbé pour faire oublier ses grands abatis, ses baisers timides puis gourmands ; tout émeut.

« Daphnis et Chloé ». Natalia de Froberville (Chloé) et le Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Le 25 octobre, on retrouve à peu près la distribution de la création en 2022. Alexandre de Oliveira Ferreira est plus charnel que Solano en Pan. C’est un faune plutôt qu’un dieu. En Daphnis, Ramiro Gomez Samon est un jeune homme idéal dans sa naïveté. La simplicité de sa variation du concours séduit. C’est un parfait berger de Pastorale. Natalia de Froberville quant à elle, montre toute la beauté classique latente dans la chorégraphie de Malandain pour Chloé. Durant sa première variation, Rouslan Savdenov, Dorcon, pastiche savoureusement le style du ballet soviétique. Tiphaine Prévost est une capiteuse et primesautière Lycénion. Elle n’est pas sans évoquer la Sirène de Balanchine dans le Fils prodigue. Sa marche en pont avec développés ou encore ses gestes explicites sont exécutés avec sobriété et efficacité. Cela rend son pas de deux final de l’épanouissement avec Dorcon d’autant plus inattendu et émouvant.

« Daphnis et Chloé ». Tiphaine Prevost et Ramiro Gomez Samon (Lycénion et Daphnis) . Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
Daphnis et Chloé est une authentique réussite de Thierry Malandain.
Par rapport à 2022, on regrettera seulement que le changement de lieu ait fait perdre un effet scénique poétique. Dans l’arène de la Halle aux grains, les chœurs cachés par le cyclo en fond de scène, étaient placés sur un balcon en face du public. Lorsqu’ils chantaient, ils apparaissaient comme flottant au-dessus de la scène, tel une assemblée des Olympiens commentant l’action. La scène du Capitole n’est pas assez profonde pour reproduire cet effet. Les excellents chœurs sont toujours placés en hauteur mais au 3e balcon de côté à Jardin, ce qui créé un certain déséquilibre pour l’oreille selon le côté où l’on se trouve dans la salle. Espérons que Daphnis pourra être repris un jour dans son écrin d’origine pour bénéficier de nouveau de cet attrait supplémentaire.

« Daphnis et Chloé ». Alexandre Ferreira De Oliveira (Pan), Natalia de Froberville et Ramiro Gomez Samon (Daphnis et Chloé), Tiphaine Prevost et Ruslan Savdenov (Lycénion et Dorcon). Ballet du Capitole. Photographie David Herrero.
*
* *
Voilà donc un bien beau programme d’hommage à Ravel. Sous la baguette inspirée de Victorien Vanoosten et avec les chœurs du Capitole dirigés par Gabriel Bourgoin, le Ballet du Capitole se montre à la hauteur de sa renommée de compagnie classique et néoclassique nationale et internationale. On s’étonne donc d’autant plus de remarquer que, dans les espaces publiques du théâtre, la plupart des photographies qui les décorent soient désormais consacrées aux productions lyriques : une photographie du Chant de la Terre de Neumeier et tout serait dit ? La saison dernière, au moins deux programmes réussis ont donné lieu à de belles photographies de David Herrero : le programme Glück-Jordi Savall et la Coppélia de Jean-Guillaume Bart. Et que dire de Daphnis et Chloé ? On espère que cet oubli n’est que conjoncturel…








































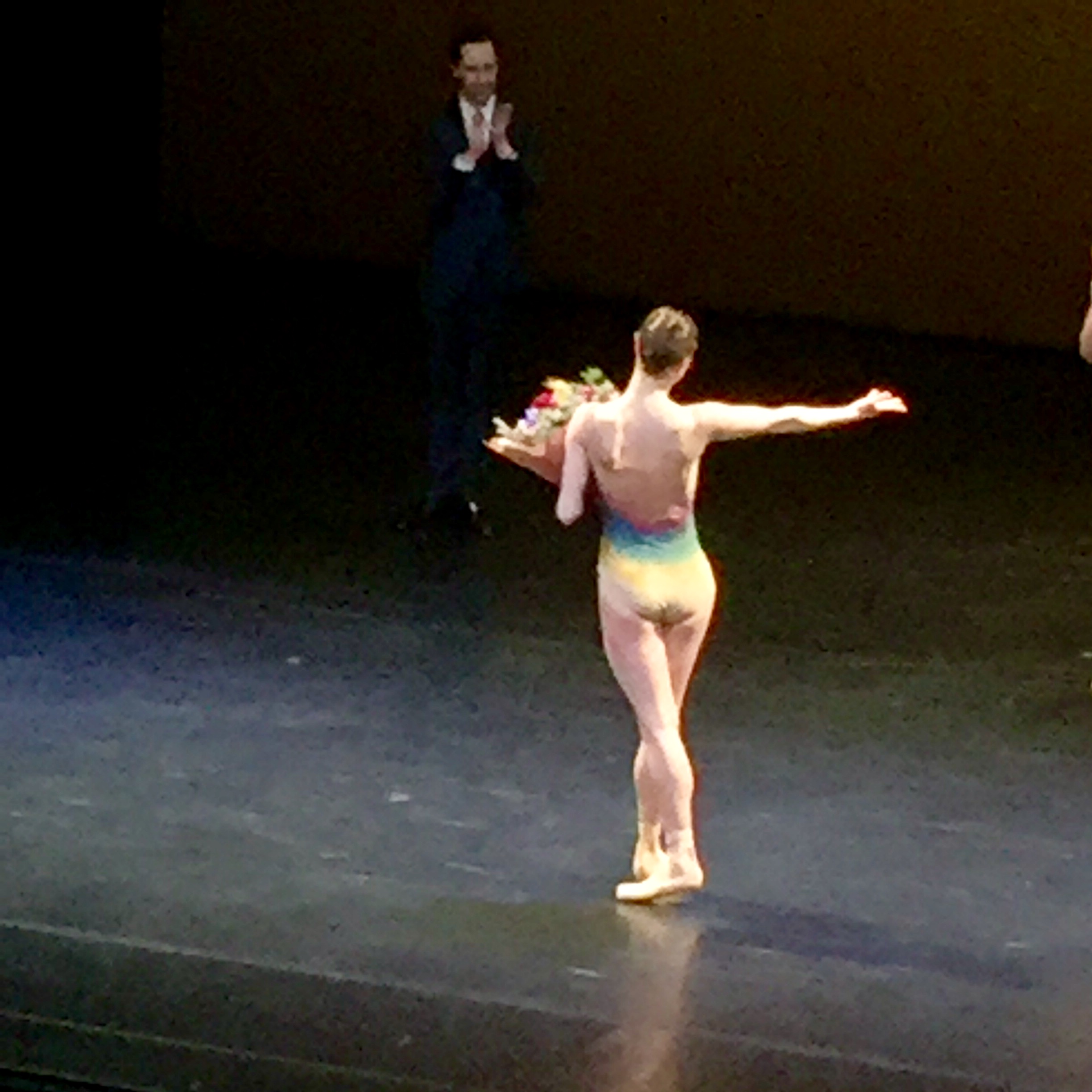











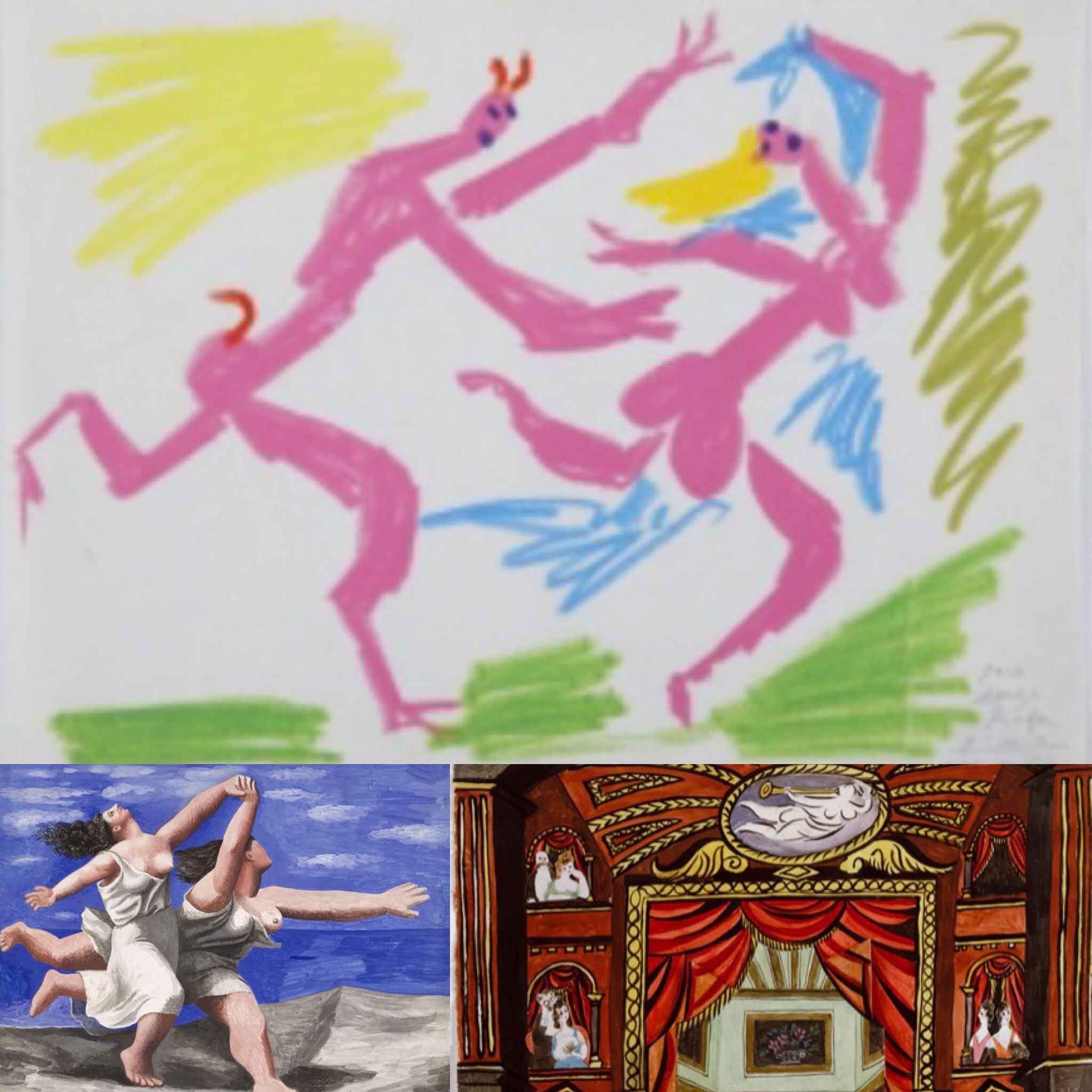 L’Après-midi d’un Faune (Honji Wang et Sébastien Ramirez / Claude Debussy et Clément Aubry, conception sonore)
L’Après-midi d’un Faune (Honji Wang et Sébastien Ramirez / Claude Debussy et Clément Aubry, conception sonore)
 Le Train bleu (Cayetano Soto / Georg Fredrich Händel)
Le Train bleu (Cayetano Soto / Georg Fredrich Händel)
 Tablao (Antonio Najarro / José Luis Montón)
Tablao (Antonio Najarro / José Luis Montón)





