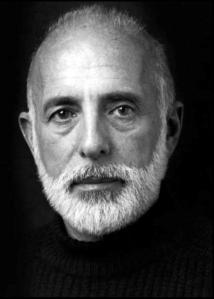
Jerome Robbins. photography © Paul Kolnik. Courtesy of Les Etés de la Danse.
Les Etés de la Danse. Hommage à Jerome Robbins, programme 1. New York City Ballet et Joffrey Ballet. Lundi 25 juin 2018 à la Seine musicale.
Voilà déjà la quatorzième édition des étés de la danse ! Cette année, le festival est encore délocalisé à la Seine musicale, une salle difficilement accessible. À la sortie du métropolitain, à l’extrême bout ouest de la ligne 9, le gros œuf en proue de l’Île Seguin semble tout proche. Il vous faut pourtant contourner tout un pâté d’immeubles et une passerelle par-dessus le fleuve pour enfin arriver au théâtre. La salle elle-même n’est pas spécialement adaptée à la danse. Depuis les places de balcon, la scène ressemble à une petite boîte dans une boîte. On se console en se disant qu’on s’est rendu ici pour assister à un programme américain et qu’à New York, on ne verrait guère mieux du haut du Fourth Ring de l’ex-State Theater ou encore du Met.
Au vu des nombreuses promotions qui ont couru sur internet, la feuille de location est un peu tristounette. C’est injuste. En dépit de l’éloignement de la salle et d’affiches publicitaires particulièrement moches (Les Étés de la Danse nous avaient habitués à beaucoup mieux), la programmation du festival est vraiment alléchante. Elle combine cette année un hommage à Jerome Robbins, qui aurait eu cent ans cette année, et la venue de pas moins de cinq compagnies connues ou moins connues du public parisien.
Le programme 1, qui réunissait le New York City Ballet et la Joffrey Ballet est de surcroît fort bien construit. Il rassemble en un panorama très complet cinq décennies de création du grand Jerry, alternativement Ballet man et Broadway man. La présentation -non chronologique- des pièces offrait une bonne respiration au public : d’abord invité à une heure suspendue sur la musique de Chopin (Dances at a Gathering, la décennie des 70), puis, après l’entracte, titillé par les accents jazzy de Morton Gould (Interplay, la décennie des années 50-60, où le chorégraphe se partage entre la création d’un répertoire de ballets américains et les musicals) avant de retourner à Bach (Suite of Dances, créé à l’orée des années 90 pour un Mikhaïl Baryshnikov en quête d’un renouveau de son répertoire). La soirée se terminait par le très roboratif Glass Pieces, réflexion du chorégraphe vieillissant sur les possibilités expressives de la danse classique sur des partitions d’abord utilisées par des chorégraphes contemporains (le ballet de 1983 intervient après la célèbre production d’Einstein on the Beach, l’opéra dansé du compositeur).
*
* *
L’interprétation de ces pièces par les deux compagnies invitées réserve son lot de découvertes, de bonnes surprises, mais aussi de déceptions.
«Dances At A Gathering» a été créé pour le New York City Ballet en 1969. Il est entré au répertoire de l’Opéra de Paris en 1991 dans une version légèrement altérée par le chorégraphe. Dans la version d’origine la danseuse en mauve, qui n’apparaît qu’après le premier tiers du ballet à Paris, danse le pas de deux avec le danseur vert dévolu à la danseuse en jaune à Paris (abricot à New York). Cette simple translation de pas change l’alchimie entre les danseurs : le couple mauve-vert semble plus fixe que dans la version parisienne où le garçon semble plus volage et où les possibilités d’intrigues entre les protagonistes de cette assemblée d’un après-midi d’été sont plus nombreuses.
C’est hélas Sara Mearns qui occupe le rôle « augmenté » de la danseuse mauve. L’interprète semble avoir un statut tout à fait privilégié dans sa compagnie d’origine. Les photographies fournies par le New York City Ballet pour Dances At A Gathering vous la proposent sur tous les clichés, en danseuse mauve mais aussi en abricot… Est-ce pour cela que son interprétation des pas de la ballerine parme apparaît si interchangeable ? Gros chignon, pieds particulièrement bruyants sur la première entrée, bras et jambes qui font flip flap dans toutes les directions autour d’un buste d’airain, elle n’apporte aucune psychologie à son personnage ni aucune interaction autre que physique avec ses partenaires.
Tiler Peck, en rose, ne convainc guère plus en dépit de qualités plus immédiatement discernables. Sa danse est efficace et son phrasé parfois intéressant. Mais il manque à son personnage cette évanescence de pétale frais qu’on attend de ce rôle. Du coup, les passages dramatiques semblent être sur le même plan que les interactions romantiques. Le dernier pas de deux avec le danseur violet – l’élégant et véloce Tyler Angle, excellent partenaire – manque de sentiment élégiaque et, par ricochet, de drame.
Avec deux trous pareils dans la distribution (et le danseur vert de Chase Finlay, tolérable mais fade), on n’échappe pas à quelques longueurs. Néanmoins, on goûte le duo du danseur en brique (Joseph Gordon) avec la danseuse en abricot (Lauren Lovette) : un moment de danse pizzicati sans le traditionnel staccato trop souvent observé aujourd’hui au New York City Ballet. Elle a de très jolis bras et une vitesse qui ne verse jamais dans la précipitation. Lui déploie une prestesse qui n’est pas exempte de moelleux. Maria Kowroski, en vert amande, liane élégante, danse délicieusement entre les tempi : c’est tout chic et charme. Il me manquera certes toujours les moulinets de poignets de Claude de Vulpian à la fin du badinage avec les danseurs violet, vert et brique mais la ballerine s’en sort avec les honneurs. La salle rit.
Et puis il y a la présence solaire de Joaquin De Luz dans le danseur en brun, aux antipodes de l’interprétation parisienne du rôle. Ici, pas de poète en recherche de muse. Concentré d’énergie explosive, il évoque immanquablement Edward Vilella, créateur du rôle. Petit gabarit (parfois même un peu trop pour ses partenaires féminines : on regrette l’absence de Megan Fairchild avec laquelle il s’accorde si bien), il joue la mouche du coche dans son savoureux duo de rivalité avec Tyler Angle. Sa variation finale est proprement jubilatoire. Soignant à l’extrême les pliés de réception de sauts, il met du coup en valeur l’envol et prend le temps de montrer les directions par des épaulements exaltés mais précis. Rien que pour lui, on ne regrette pas le périple qui nous a conduit sur l’île Seguin.

NewYorkCityBallet-Dances At A Gathering02-Photo © Paul Kolnik
« Interplay », est le ballet idéal pour approcher Jerome Robbins, « the broadway man ». Conçu pour des danseurs classiques en 1945, il utilise la technique académique avec de petits twists sans pour autant verser dans la couleur locale de « Fancy Free » ou nécessiter que les danseurs sachent chanter comme dans « West Side Story Suite » : pieds ancrés dans le sol et marches en crabe mais pyrotechnie à tout va caractérisent la pièce. Les garçons font même des roulades soleil pour épater les filles dans le quatrième mouvement. On se prend à s’étonner que les danseurs portent chaussons et pointes quand on les imaginait porter des baskets. La musique de Morton Gould, tour à tour rythmique et primesautière, ferait bondir un mort de sa bière.
Le Joffrey Ballet, peu connu chez nous, déploie la bonne énergie dans cette pièce rarement montrée à Paris. Les quatre garçons retiennent particulièrement l’attention. Le premier mouvement est mené avec beaucoup d’énergie par Elivelton Tomazi (en vert). Yoshihisa Arai (en rouge) incendie le deuxième mouvement de sa belle ligne, de sa grande élévation et de ses petits frappés de mains presque baroques. Pendant le Pas de deux, le reste de la distribution prend des poses sensuelles en ombre chinoise. Une sensualité qui manque un peu au pas de deux lui-même. Le danseur en bleu, Alberto Velasquez déploie ce qu’il faut de mâle assurance mais sa partenaire en rose, Christine Rocas, semble un peu étrangère a l’action.
« Suite of Dances », sur des pièces pour violoncelle de Bach, qui succède à Interplay, en est finalement moins éloigné qu’on serait tenté de le penser de prime abord. On retrouve ce génie de Robbins pour la greffe de détails extérieurs à la tradition académique qui lui donnent une nouvelle vitalité. Ici, il ne s’agit pas de mouvements empruntés au jazz (Interplay) ou aux danses nationales polonaises (Dances) mais des tics de cabotinage d’un grand danseur (marche avec les hanches en-avant, petits tours jambes repliées, jeu sur les pertes de direction, etc…). Cette partition, taillée sur mesure pour Baryshnikov a néanmoins continué d’être interprété quand son créateur n’a lui-même plus été en mesure de l’interpréter. Anthony Huxley, nouvelle incarnation du danseur au pyjama rouge, est moelleux, musical et élégant. Il installe un dialogue avec sa partenaire instrumentiste. Mais il lui manque le fond de cabotinage qui met en valeur les incongruités de la chorégraphie. On assiste à un récital de – belles – danses savantes sans jamais vraiment atteindre un quelconque Nirvana. On aurait aimé voir Anthony Huxley dans le danseur en brique ou en brun de Dances at a Gathering. Et que d’inventions comiques aurait apporté Joaquim de Luz dans « Suite »… C’était hélas pour la seconde distribution…
Pour « Glass Pieces » qui concluait la soirée, on dresse le même constat que pour Interplay. Au Joffrey, les garçons sont globalement plus palpitants que les filles. Le premier mouvement sur le quadrillage en cyclo de fond a un côté plus humain et moins graphique qu’à Paris. Pourquoi pas : l’effet est moins cluster d’écran vidéo et plus piétons des rues. Dans le deuxième mouvement avec sa frise de filles en ombre chinoise (Robbins savait renouveler des effets qu’il avait déjà utilisés ailleurs), Miguel Angel Bianco est ce qu’il faut de sculptural pour figurer un haut relief de chair, mais aucune sensualité ne se dégage de son duo avec sa partenaire Jeraldine Mendoza. Pour le final, l’entrée des garçons est galvanisante. Il s’en dégage une énergique presque tribale. Mais ça s’essouffle avec l’entrée des filles en guirlande sur le thème de flûte. Dommage…

GlassPieces-JoffreyBallet-CompanyDancers–Photo © Cheryl Mann
Mais ne boudons néanmoins pas notre plaisir. Ce n’est pas souvent qu’à Paris, on assiste à un hommage aussi bien construit et complet.
[Le programme 2 de l’hommage à Robbins joue du jeudi 28 au samedi 30 juin à la Seine Musicale]

 Il est des plaisirs régressifs qui ne se questionnent pas. Et qu’importe si leur goût est discutable. Vous souvenez-vous de ces sucreries industrielles au goût chimique qui collaient aux dents et vous laissaient la langue d’une couleur douteuse? Ou alors le film sirupeux qui passait immanquablement à la télé au moment des fêtes ? Ils se parent de la nostalgie de l’enfance. Tous ces artefacts de la vie d’avant dépassent alors leur qualité intrinsèque. Aux USA, et tout particulièrement à New York, l’un de ces petits plaisirs coupables n’est autre que le Nutcracker. Là-bas, dites à quiconque que vous vous y rendez et vous verrez des lumières s’allumer dans les yeux et des récits d’enfance surgir tout naturellement. Quand, avec qui, dans quel accoutrement. Il y a aussi les innombrables ex-enfants (deux distributions de 63 par saison au New York City Ballet) qui y ont joué un rôle, même si c’était dans une production secondaire. À New York, le moment du ballet qui suscite le plus d’admiration est celui où l’arbre de Noël grandit. Rien, vous dira-t-on n’est, n’a été ou ne sera plus beau que cela.
Il est des plaisirs régressifs qui ne se questionnent pas. Et qu’importe si leur goût est discutable. Vous souvenez-vous de ces sucreries industrielles au goût chimique qui collaient aux dents et vous laissaient la langue d’une couleur douteuse? Ou alors le film sirupeux qui passait immanquablement à la télé au moment des fêtes ? Ils se parent de la nostalgie de l’enfance. Tous ces artefacts de la vie d’avant dépassent alors leur qualité intrinsèque. Aux USA, et tout particulièrement à New York, l’un de ces petits plaisirs coupables n’est autre que le Nutcracker. Là-bas, dites à quiconque que vous vous y rendez et vous verrez des lumières s’allumer dans les yeux et des récits d’enfance surgir tout naturellement. Quand, avec qui, dans quel accoutrement. Il y a aussi les innombrables ex-enfants (deux distributions de 63 par saison au New York City Ballet) qui y ont joué un rôle, même si c’était dans une production secondaire. À New York, le moment du ballet qui suscite le plus d’admiration est celui où l’arbre de Noël grandit. Rien, vous dira-t-on n’est, n’a été ou ne sera plus beau que cela.



